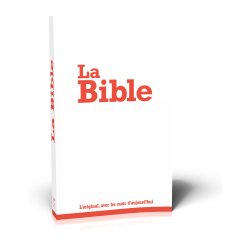Confronté à une Eglise corrompue, Martin Luther donne le coup d’envoi de la Réforme le 31 octobre 1517. Ses thèses se répandent rapidement en Europe du Nord. Zurich et Genève deviennent des foyers importants des nouvelles idées, grâce à l’action de Huldrych Zwingli et de Jean Calvin.
En ce début de XVIe siècle, l’Eglise d’Occident ne répond plus depuis longtemps aux besoins des fidèles. Trop de compromissions temporelles, trop d’autoritarisme… Les clercs sont ignorants. Les évêques cumulent des sièges épiscopaux pour gagner de l’argent. Les papes ne songent qu’à embellir Rome et la basilique Saint-Pierre, et à organiser des fêtes. Pour couvrir les énormes frais que requièrent leurs goûts artistiques, ils vendent des indulgences. En les achetant, dit l’Eglise, l’homme obtient la remise des peines impliquées par son péché. Il peut même espérer gagner le Paradis…
Les hommes et les femmes du début du XVIe siècle vivent dans l’anxiété. La mort et Satan, partout présents, les effraient. La chasse aux sorcières, approuvée officiellement en 1484 par une bulle du pape Innocent VIII, a connu un regain au XVe siècle, et durera jusqu’au milieu du XVIIe. Cent mille personnes laisseront leur vie sur les bûchers. Les flammes sont également le sort de ceux qui exigent une réforme vigoureuse de l’Eglise. A cette époque, Dieu lui-même fait peur: de nombreux chrétiens voient en lui un juge impitoyable, qui les condamnera au jour du Jugement dernier.
C’est dans ce contexte qu’apparaît Martin Luther. Né en 1483 à Eisleben en Thuringe, il devient moine en 1505 à Erfurt à la suite d’un événement important, dont il n’a jamais parlé. Il applique rigoureusement la règle et mène une vie austère. Pourtant, une sourde inquiétude ne cesse de le travailler. Il ne pèche pas, c’est entendu. Mais il constate que la propension au péché – ce qu’il appelle la concupiscence – reste bien ancrée au tréfonds de lui-même.
Martin Luther est rongé par l’angoisse: si, quoi qu’il fasse, l’homme est et reste pécheur, qu’advient-il de son salut? La terrible justice de Dieu peut-elle épargner à cet homme, qui lutte pour obtenir le salut, mais qui toujours trébuche, la damnation éternelle? Luther en vient à haïr Dieu lui-même. Pourtant, en méditant l’Epître aux Romains de Paul, il finit par comprendre que le salut ne s’obtient pas en s’abstenant de pécher, ce qui est impossible, mais par la seule foi en Jésus-Christ, donnée par la grâce de Dieu. Dieu justifie l’homme gratuitement – le sauve – par le don de la foi. L’homme reste totalement passif face à cette justice: il ne peut donc coopérer à son salut par de bonnes œuvres. Si celles-ci sont bien la conséquence d’un être justifié par la foi, elles n’ont aucun pouvoir de rédemption.
Fort de ses nouvelles convictions, Luther s’en prend aux indulgences, qui font croire aux hommes qu’ils peuvent acheter leur salut et celui de leurs défunts. Un prédicateur de ce temps ne dit-il pas: «Une âme monte au ciel quand la pièce sonne au fond du tronc?» Le 31 octobre 1517, Luther donne le coup d’envoi de la Réforme à Wittenberg, où il enseigne les Ecritures, en publiant 95 thèses sur les indulgences. Le conflit avec la papauté est inévitable, même si Luther n’a aucune intention de créer une nouvelle Eglise.
Au cours de diverses disputes théologiques, le moine expose sa doctrine de la justification par la foi, affirme que l’Ecriture est la seule autorité pour les chrétiens, que le pape n’est pas infaillible et demande la réunion d’un nouveau concile. Sommé le 15 juin 1520 de se rétracter sous peine d’excommunication, Luther affine au contraire sa pensée dans les derniers mois de l’année.
Des sept sacrements en vigueur, il en conserve deux, le baptême et la cène, les seuls qui soient attestés dans les évangiles. Il élabore la théorie du sacerdoce universel, selon laquelle tous les croyants sont invités à devenir les interprètes inspirés de l’Ecriture. Il est excommunié en janvier 1521 et mis au ban de l’Empire par Charles Quint en mai. Un prince allemand le prend sous sa protection. Caché dans un château, Luther entreprend de traduire la Bible en allemand.
Il sortira de sa retraite pour reprendre les rênes de la Réforme qui risquaient de lui échapper au profit de groupes intransigeants. Ses idées se répandront rapidement en Allemagne et ailleurs, au prix de graves conflits avec Charles Quint et les Etats allemands restés catholiques.
Plusieurs étapes jalonnent la progression du luthéranisme. La diète de Spire en 1529, qui voit les princes des Etats allemands gagnés à la Réforme protester (d’où le nom «protestants») contre Charles Quint qui veut leur retirer la liberté de professer leur foi, pourtant accordée en 1526. La confession d’Augsbourg, présentée à l’empereur en 1530, qui est encore aujourd’hui le texte de référence des Eglises luthériennes. Le concile de Trente (1545-1563), qui marque la rupture définitive entre Rome et les protestants. La Paix d’Augsbourg de 1555, qui reconnaît la division confessionnelle de l’Allemagne et accorde aux Etats protestants le droit de professer leur foi, et impose aux individus d’embrasser la religion de leurs princes. La Formule de Concorde de 1577, qui apaise les controverses internes au luthéranisme et qui, avec la Confession d’Augsbourg et d’autres textes, constitue le canon de la foi luthérienne.
Presque en même temps que Wittenberg, Zurich devient un des principaux pôles de la Réforme. Nourri par la lecture d’Erasme et du Nouveau Testament, en particulier les épîtres de Paul, Huldrych Zwingli, né en 1484 dans le Toggenbourg, devient prédicateur et curé de la collégiale de Zurich en 1519. Il semble avoir adopté une position réformatrice vers 1520, sans avoir été influencé par Luther. Zwingli est soutenu dans sa volonté réformatrice par le Conseil de Zurich, rapidement convaincu par ses arguments. La réforme prônée par Zwingli, accomplie pour l’essentiel de 1524 à 1525, est très proche de celle de Luther: seule l’Ecriture fait autorité, la messe est abolie, les images supprimées dans les sanctuaires, les couvents sécularisés.
Pourtant, un élément essentiel sépare Luther et Zwingli, qui empêchera toute entente entre les deux réformateurs. Alors que le premier estime que le Christ est réellement présent dans l’Eucharistie, le second ne voit dans ce sacrement qu’un symbole. La Réforme s’étend dans la Confédération et gagne plusieurs cantons. Une guerre civile éclate entre cantons protestants et catholiques. En 1531, Zwingli meurt à la bataille de Cappel. Henri Bullinger poursuit à Zurich son œuvre réformatrice et conclut en 1549 avec Calvin le Consensus Tigurinus, qui contribua largement à unir les réformes de Calvin et de Zwingli dans la confession qu’on appelle aujourd’hui «réformée».
Après Wittenberg, Zurich et Strasbourg – qui était devenu un foyer très actif de la Réforme grâce à Martin Bucer – c’était au tour de Genève de rallier le mouvement. Jean Calvin, originaire de Noyon en Picardie, où il est né en 1509, arrive une première fois à Genève en 1536, où il fait halte alors qu’il se rend à Strasbourg. Il a rompu avec l’Eglise romaine en 1534. En mars 1536, il a publié l’Institution de la religion chrétienne, pour présenter la foi évangélique au roi François Ier. Cet ouvrage, réédité et traduit à de très nombreuses reprises, deviendra la somme théologique de la Réforme.
Le Dauphinois Guillaume Farel presse Calvin de rester à Genève pour y organiser la Réforme, qu’il prêchait dans cette ville depuis 1532. Calvin accepte et commence à organiser la structure de l’Eglise. Mais il rencontre rapidement l’opposition du magistrat et des bourgeois sur deux points litigieux: le droit qu’il demande pour l’Eglise d’excommunier les grands pécheurs et l’obligation pour tous les citoyens de signer une profession de foi. Le réformateur picard quitte Genève en 1538 et s’installe à Strasbourg.
En l’absence de Calvin et de Farel, qui s’est fixé à Neuchâtel, la situation se dégrade à Genève. Le magistrat demande à Calvin de revenir. Le réformateur accepte à contrecœur. Il arrive en 1541, et restera à Genève jusqu’en 1564, date de sa mort. Il amènera les Genevois à vivre selon l’Evangile au moyen d’une discipline ecclésiastique rigoureuse et ne manquera pas de se faire de nouveaux ennemis. Mais il tiendra bon. Son succès sera consacré en 1559 par la création d’une Académie dont la réputation se répandra rapidement dans toute l’Europe. A la mort de Calvin, Théodore de Bèze assurera la continuité de son œuvre réformatrice.
Au XVIe siècle, la Réforme s’ancrera également en France, malgré d’affreux massacres, comme celui de la Saint-Barthélemy, et en Angleterre, qui trouvera une voie médiane entre protestantisme et catholicisme. Pendant l’épanouissement de la Réforme, l’Eglise catholique n’est pas restée inactive. La papauté s’est enfin décidée à convoquer un concile réformateur à Trente, qui portera ses plus beaux fruits au XVIIe siècle.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 1507 | Promulgation de l’indulgence pour Saint-Pierre de Rome |
| 1509 | Erasme publie l’«Eloge de la folie» |
| 1509 | Henri VIII est roi d’Angleterre |
| 1515 | François Ier est roi de France |
| 1517 | Thèses de Luther sur les indulgences |
| 1521 | Diète de Worms et bannissement de Luther |
| 1530 | Confession d’Augsbourg |
| 1540 | Fondation de la compagnie de Jésus |
| 1545 | Ouverture du concile de Trente |
| 1562 | Début des guerres de religion, réforme de sainte Thérèse d’Avila |
| 1563 | Clôture du concile de Trente |
| 1572 | Massacre de la Saint-Barthélemy |
| 1598 | Edit de Nantes |