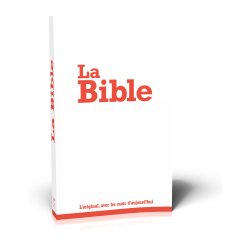Grâce à l’action de Charlemagne, l’étude des lettres est remise au goût du jour. Dans les monastères unifiés par l’adoption de la Règle de saint Benoît, les moines recopient les classiques latins, et les transmettent ainsi à la postérité.
«Je te baptise au nom de la patrie et de la fille.» «In nomine patria et filia»: la formule, utilisée par un clerc bavarois du VIIIe siècle au latin plus que douteux, illustre bien l’état de délabrement intellectuel et culturel dans lequel vivent les chrétiens occidentaux à l’aube de ce que les historiens ont appelé la renaissance carolingienne. Les illettrés forment le gros des troupes chrétiennes, qu’il s’agisse des régiments d’Eglise ou de ceux du peuple. Le latin, rongé peu à peu par les langues vernaculaires, se perd. L’œuvre du temps rend les manuscrits illisibles.
Or Charlemagne, roi des Francs depuis 768 et sacré empereur en l’an 800, veut assurer le renouveau de la culture, dont il pressent l’utilité pour améliorer les structures de son royaume. Bien que lui-même n’ait pas reçu d’instruction, il souhaite créer un enseignement pour les clercs qu’il destine à l’administration de l’Empire.
Au VIIIe siècle, il avait désigné un maître d’œuvre pour accomplir la réforme qui lui tenait à cœur: Alcuin (735-804). En 781, ce savant accepta de diriger l’école palatine d’Aix-la-Chapelle, ville qui devint le fief de Charlemagne en 794. Il conçut un véritable programme scolaire, basé sur la redécouverte des lettres profanes antiques, dont la grammaire et la rhétorique. L’apprentissage de cette culture servait à mieux comprendre et à commenter l’Ecriture et les ouvrages des Pères de l’Eglise. Elle fut diffusée dans les paroisses, les monastères et les cathédrales. L’Occident doit à Alcuin la propagation d’une nouvelle écriture, la fameuse minuscule caroline, qui est devenue notre «bas-de-casse» dans la typographie actuelle. Elle a facilité la transmission calligraphique des manuscrits antiques à travers les siècles.
Parmi ses tâches, Alcuin dut organiser les scriptoria dans les monastères de l’Empire, où les moines s’adonnaient à la copie des manuscrits des Pères de l’Eglise et des auteurs de l’Antiquité. Commencé au VIIIe siècle, le renouveau carolingien donna ses plus beaux fruits au siècle suivant. Les successeurs de Charlemagne, notamment son fils Louis le Pieux, approfondirent son œuvre. C’est d’ailleurs du IXe siècle que nous sont parvenus les plus vieux textes intégraux de nombre de classiques latins. «La dette que la culture européenne doit aux scribes carolingiens est immense; sans eux, la connaissance des lettres latines en particulier n’aurait pas été possible», affirme l’historien Pierre Riché*. Les monastères germaniques de Saint-Gall, de Fulda et de Reichenau figurent parmi les centres d’études les plus importants du IXe siècle.
Charlemagne, qui était aussi le chef de l’Eglise, aimait à intervenir personnellement dans les affaires de cette dernière. L’époque le permettait, qui voyait le politique et le religieux, dont les contours étaient flous, constamment s’entremêler. En 789, le roi carolingien fait ainsi adopter l’Admonitio generalis, un recueil de lois destinées aux prêtres, aux moines et aux évêques, qui ordonnaient l’ouverture d’écoles dans les monastères et les évêchés.
Une fois devenu empereur, Charlemagne multiplie les assemblées pour diriger l’Eglise. Il nomme les évêques et les abbés, renforce les structures ecclésiastiques. Il accorde beaucoup d’attention aux monastères, qu’il veut réformer et stabiliser en les plaçant sous l’autorité d’une règle unique. Celle de saint Benoît de Nursie, un moine qui avait vécu au VIe siècle, apparaît rapidement comme la plus équilibrée. Mais c’est à Louis le Pieux, fils de Charlemagne, que revient la tâche d’imposer la règle bénédictine aux quelque 650 monastères que compte l’Empire.
En 814, le nouvel empereur fait venir auprès de lui Benoît d’Aniane, fondateur d’une abbaye à l’ouest de Marseille. Il l’installe dans le monastère d’Inde (Cornélimünster), à quelques kilomètres d’Aix-la-Chapelle. Tous deux préparent une importante réunion, à laquelle sont conviés les abbés de l’Empire. Le synode s’ouvre en juillet 817. Louis le Pieux fait approuver le Capitulare monasticum, un texte de 83 articles qui codifie la vie monastique selon la règle bénédictine, revue et corrigée par Benoît d’Aniane. Ce dernier meurt en 821, mais sa réforme lui survivra, préparant le terrain au rayonnement de Cluny au siècle suivant.
Les historiens ont ainsi pu dire de saint Benoît de Nursie qu’il a été le père de l’Europe. Sa règle a unifié la vie monastique et créé une réelle solidarité entre les moines de l’Empire. La règle bénédictine traversa sans dommage la sécularisation qui suivit le partage et la décadence de l’Empire carolingien, et qui vit nombre de monastères sombrer dans la misère ou le néant.
Le renouveau carolingien n’a pas tant touché la pensée que les structures de base qui permettaient sa diffusion et son développement. Le IXe siècle n’a donc pas brillé par une vie intellectuelle touffue. Néanmoins, une controverse théologique importante, l’affaire du «Filioque», a contribué à l’approfondissement du fossé entre l’Orient et l’Occident, et constitue encore aujourd’hui un obstacle à un rapprochement entre Rome et les Eglises orthodoxes.
En 381, le concile de Constantinople avait complété le Credo de Nicée en ajoutant une référence à l’Esprit Saint. Les fidèles confessaient ainsi, en plus de Dieu et de Jésus-Christ, l’Esprit Saint «qui procède du Père». Or, en Espagne, à la fin du VIe siècle, des théologiens wisigoths avaient proclamé que l’Esprit Saint procède «du Père et du Fils (Filioque)». La formule séduisit les clercs carolingiens qui la considérèrent comme théologiquement correcte. Mais, pour Constantinople, celle de 381 était intangible.
Au début du IXe siècle, Charlemagne, en froid avec l’Empire d’Orient, voulut convaincre les Grecs d’erreur et confia à ses théologiens la tâche de justifier le «Filioque». En 809, il fit approuver par un concile la double procession du Saint Esprit. La querelle rebondit en 867, lorsque le patriarche Photius dénonça le «Filioque» comme une doctrine hérétique dans une lettre à ses pairs orientaux. Photius était excédé pour plusieurs raisons. Il avait appris que le clergé romain exigeait l’emploi du «Filioque» en Bulgarie, pays converti par des missionnaires byzantins mais qui avait demandé au pape Nicolas Ier (858-867) la création d’une hiérarchie ecclésiastique. Ce dernier en avait profité pour établir sa juridiction sur le royaume bulgare. Le pape avait aussi refusé de ratifier l’élection de Photius au patriarcat de Constantinople, et excommunié ce dernier. Nicolas Ier souhaitait le rétablissement de l’ancien patriarche Ignace, contraint à la démission en 856. L’ingérence du pape dans les affaires byzantines avait été très mal prise à Constantinople.
Bien que la paix fût rétablie dans la chrétienté, la querelle photienne et le «Filioque» ont créé des séquelles profondes dans les relations entre l’Orient et l’Occident. La controverse sur la primauté du pape, toujours actuelle, remonte à cette époque. Comme le remarque l’historien David Knowles**, «l’importance de la querelle photienne réside principalement dans le fait qu’au cours de cette affaire eut lieu la première rupture déclarée entre la conception romaine de la primauté du siège de Rome, telle qu’elle avait été définie par Léon le Grand et Gélase et telle que la réaffirmait désormais avec vigueur Nicolas Ier, et le point de vue de l’Eglise d’Orient sur la nature de l’autorité et du gouvernement ecclésiastique».
La primauté de Rome avait été reconnue dès le IVe siècle par Constantinople. Mais sa nature n’avait jamais fait l’objet d’une définition acceptée de part et d’autre. Pour les Byzantins, il était clair qu’elle devait s’arrêter à la frontière qui délimitait les affaires internes à l’Eglise d’Orient. Primauté ne signifiait pas à leurs yeux le gouvernement monarchique de l’Eglise universelle auquel prétendait Nicolas Ier. Au siècle suivant, l’état lamentable de la papauté, qui traverse la période la plus noire de son histoire, ne pourra que confirmer les Byzantins dans leur idée que les Latins sont des barbares incultes et rustres.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 804 | Mort d’Alcuin, «ministre de l’Instruction publique» de Charlemagne |
| 813-840 | Règne de l’empereur Louis le Pieux |
| 814 | Mort de Charlemagne |
| 817 | Aix-la-Chapelle: Règle de saint Benoît adoptée |
| 843 | Le Traité de Verdun partage l’Empire en trois zones: France, Germanie, Lotharingie |
| 843 | Concile de Constantinople: fin de la seconde crise iconoclaste |
| 846 | Mise à sac de Saint-Pierre de Rome par des pirates musulmans |
| 858-867 | Pontificat de Nicolas Ier et première période du patriarcat de Photius |
| 860 | Les Russes attaquent Constantinople |
| 863 | Voyage missionnaire de Cyrille et Méthode en Moravie |
| 867-869 | Schisme de Photius |
| 867-874 | Conversion des Serbes à l’orthodoxie |
| 877-886 | Seconde période du patriarcat de Photius |
| 887 | Chute de l’Empire franc |
* Pierre Riché, Histoire du christianisme, vol. 4, Desclée, 1993.
** David Knowles et Dimitri Obolensk, «Nouvelle Histoire de l’Eglise», vol. 2, Seuil, 1968.