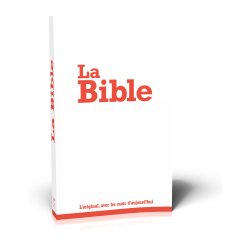Alors que chute l’Empire, une nouvelle ère commence, avec deux centres religieux. L’évangélisation et le monachisme progressent, et la papauté se met réellement à exister.
«Tout à coup, on vint m’annoncer la mort de Pammachius, de Marcella, la prise de Rome, la mort d’un grand nombre de nos frères et de nos sœurs. J’en ai été consterné, bouleversé, stupéfié. Jour et nuit, je ne pensais plus à autre chose, je me croyais captif avec eux, ces saints […]. Aucune œuvre créée que la vieillesse n’attaque et ne fasse disparaître. Mais Rome! Qui pouvait penser qu’édifiée avec les victoires remportées sur le monde entier, elle s’écroulerait, devenant le tombeau des peuples dont elle avait été la mère?»
Saint Jérôme, le moine qui avait plaidé la cause du monachisme à Rome au IVe siècle, se trouve à Bethléem lorsqu’il apprend que les Wisigoths d’Alaric ont pris et saccagé la ville. L’événement a lieu en 410, et les années qui suivent n’apportent que cris et malheurs. Les Vandales déferlent sur l’Afrique du Nord. En 430, saint Augustin meurt dans Hippone assiégée. Les Huns d’Attila atteignent l’Occident: ils sont repoussés à Troyes en 451. En 455, Rome subit l’assaut des Vandales de Genséric. La chute de l’Empire est aussi provoquée par une implosion interne: de nombreux Barbares étaient mercenaires dans les armées. Ainsi Odoacre, qui s’empare de Rome en 476.
«Le monde antique, tant romain que chrétien, avait cessé d’exister, souligne Jean Comby, professeur aux Facultés catholiques de Lyon, dans son livre Pour lire l’Histoire de l’Eglise*. Une nouvelle ère commençait. L’Empire se maintenait en Orient, mais l’Occident latin avait éclaté en une multitude de royaumes barbares: Ostrogoths, Wisigoths, Burgondes, Vandales, Alamans, etc.» Le Ve siècle voit le fossé entre l’Orient et l’Occident s’agrandir. Politiquement, les régions d’Europe sont aux mains de divers rois, alors qu’en Orient le règne impérial se poursuit.
Les querelles théologiques sont de natures différentes. Tandis qu’en Orient, divers mouvements se battent à coups de conciles au sujet de la nature du Christ, l’Occident paraît moins agité par des débats intellectuels et tente d’éradiquer l’hérésie appelée pélagianisme**. L’unité culturelle entre Latins et Grecs se rompt: chacun ignore la langue de l’autre, et l’Eglise d’Occident acquiert son autonomie doctrinale grâce à des penseurs de langue latine.
Géographiquement, l’Occident et l’Orient n’ont plus de liens, puisque l’Illyrie (qui correspond à l’ancienne Yougoslavie et à l’Albanie), traditionnel pont entre ces deux territoires, a été envahie par les Barbares. Deux centres religieux s’affirment, qui s’opposeront à plusieurs reprises: d’un côté, Rome, dont la primauté d’honneur a été traditionnellement reconnue par toutes les Eglises jusqu’à la fin du IVe siècle et où la papauté fait ses premiers pas; de l’autre, Constantinople, capitale de l’Empire depuis 330, et qui revendique les mêmes privilèges que Rome. Bref, le christianisme se divise et présente désormais deux destins différents, dont la séparation effective sera consacrée en 1054 par un schisme.
Avec les invasions barbares, l’Occident croit la fin du monde arrivée. De nombreux chrétiens pensent que l’Eglise, en si parfaite symbiose avec l’Empire au siècle précédent, ne pourra pas survivre. C’est oublier que la plupart des peuples barbares, les Francs exceptés, sont déjà christianisés au moment où ils envahissent l’Occident. Christianisés, oui, mais de confession arienne, l’hérésie qu’a condamnée le concile de Nicée en 325.
Les évêques catholiques ont donc fort à faire pour convertir les barbares à leur foi, surtout en Afrique, où les Vandales ont tenté d’imposer l’arianisme dans le sang. Cependant, la tâche des évêques est singulièrement facilitée par l’aura et le prestige dont se pare leur fonction en ce Ve siècle. Au sein de l’effondrement général, l’Eglise a tenu bon. Hiérarchisée, structurée, détentrice d’un savoir et d’une culture, elle apparaît comme le seul centre d’autorité, et souvent elle supplée aux devoirs temporels que les peuples germaniques sont incapables de mener à bien. La domination des Barbares s’avère relativement douce en plusieurs endroits. En Italie, les Ostrogoths se montrent respectueux face à l’héritage romain. En Espagne et en Gaule, les Wisigoths adoptent la même attitude. Les Burgondes, qui s’installent autour de Genève et de Lyon, aussi. Les Vandales respectent la civilisation romaine. La conversion de Clovis, roi des Francs, tout au début du VIe siècle, amènera également ce peuple dans le cercle d’influence chrétien.
Bien que l’on assiste çà et là à des résurgences païennes, l’évangélisation de l’Occident se poursuit, tant dans les villes que dans les campagnes. Rome apparaît comme le centre de l’Eglise latine. La reconnaissance du primat romain progresse dans tous les domaines: dogmatique, disciplinaire et juridictionnel. C’est au Ve siècle que la papauté se met réellement à exister. En 381, le concile de Constantinople avait consacré la primauté d’honneur de la nouvelle capitale impériale, qui restait toutefois seconde après Rome. L’évêque de cette dernière, Damase, avait alors pris ombrage de cette décision. C’est lui qui avait donné au siège de Rome son titre d’«apostolique». A ses yeux, Rome devait sa primauté non à une décision politique, mais au fait que l’apôtre Pierre, auquel le Christ avait remis ses pouvoirs, avait résidé dans cette ville. Damase innova aussi en appelant les autres évêques ses fils et non ses frères. Sirice (384-399) fut le premier à s’octroyer le titre de pape au sens de Père des autres évêques.
En effet, jusqu’au Ve siècle, le terme pape (papa en latin) est utilisé pour désigner n’importe quel évêque sur le mode affectueux. Durant quatre cents ans, l’évêque de Rome a donc été un évêque comme un autre. Cependant, il était reconnu comme un primus inter pares: l’importance de la ville dont il était le chef spirituel l’amenait à exercer un certain pouvoir doctrinal reconnu par l’ensemble des Eglises. Celles-ci s’adressaient à l’évêque de Rome quand elles étaient incapables de trancher leurs conflits doctrinaux.
Au Ve siècle, Léon Ier (440-461) prend le titre de pontifex maximus, que l’empereur avait abandonné au IVe siècle, s’attribue le droit de diriger l’ensemble de l’Eglise et invite les autres évêques à se soumettre à son autorité. Léon refuse le 28e canon du concile de Chalcédoine (451) qui fait de Constantinople l’égale de Rome. Conscient de ses prérogatives, il s’adresse avec autorité aux rois barbares.
L’évangélisation progresse, le monachisme aussi. Les ordres existants étendent leur domaine d’influence. L’abbaye de Lérins essaime jusqu’en Valais: l’abbaye de Saint-Maurice est fondée en 515. De nouveaux ordres font leur apparition, les règles prolifèrent.
La fameuse règle de saint Benoît, appelée à un grand avenir et encore appliquée aujourd’hui, remonte à ce contexte. Mais ce monachisme s’inspire encore de son ancêtre égyptien: c’est la fuite du monde et le renoncement à ses illusions, dont le savoir intellectuel, qui pousse les hommes et les femmes à choisir ce mode de vie. Le monachisme savant et cultivé ne fera son apparition qu’aux VIIe et VIIIe siècles. La piété populaire se développe aussi, avec le culte, souvent mâtiné de superstitions et d’outrances, des martyrs et des saints.
Indéniablement, la culture antique a disparu sous les coups de boutoir des Barbares. D’un point de vue intellectuel et culturel, l’époque est sombre, avec toutefois des poches de lumière. Le christianisme occidental va insensiblement entrer dans l’ère qu’un millénaire plus tard on appellera le «Moyen Age».
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 410 | Prise et pillage de Rome par Alaric |
| 411 | Condamnation du moine Pélage |
| 430 | Mort de saint Augustin |
| 431 | Concile d’Ephèse |
| 440 | Léon Ier le Grand, pape |
| 451 | Concile de Chalcédoine |
| 455 | Prise de Rome par Genséric |
| 476 | Fin de l’Empire romain en Occident |
| 482 | Clovis roi des Francs |
| 484 | Justin empereur d’Orient |
| 486 | L’Eglise perse passe au nestorianisme |
| 491 | L’Eglise d’Arménie opte pour le monophysisme |
| Vers 500 | Baptême de Clovis |
* Jean Comby, Pour lire l’Histoire de l’Eglise, Le Cerf, 1984
** Le pélagianisme est une doctrine qui insiste sur la responsabilité de l’homme dans son salut. Grâce à la liberté qui lui est conférée, l’homme a la possibilité, s’il pratique la vertu, d’atteindre un état de sainteté et de ne pas connaître le péché. Dans ces conditions, la notion de péché originel est minimisée, voire niée.