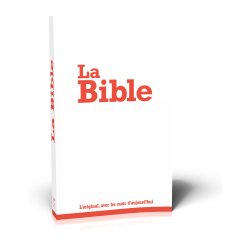L’évangélisation progresse, l’organisation ecclésiastique devient plus efficace, et le christianisme commence à briller intellectuellement. Mais l’Empire romain, décadent, veut réunifier la population autour du culte impérial. La bataille est inévitable.
Origène a dix-sept ans lorsqu’éclate en 202 la persécution de l’empereur Septime Sévère contre les chrétiens. Ce jeune homme prometteur est né à Alexandrie dans une famille chrétienne. Il a échappé de justesse à la persécution, mais son père figure parmi les victimes. Origène en sera très marqué. A dix-sept ans donc, il devient responsable de sa famille. Il embrasse la profession de professeur de lettres, puis de catéchète, avant de retourner aux études. Il s’intéresse aussi bien à la philosophie néoplatonicienne qui baigne toute l’époque qu’à la logique, la dialectique, aux sciences de la nature, à l’éthique et à l’exégèse de l’Ecriture sainte.
Origène a sans aucun doute été le plus grand théologien et dogmaticien de son siècle: son mérite est d’avoir su utiliser la fine fleur de la culture antique au service de la pensée chrétienne et de l’exégèse, à laquelle il donne sa méthode. Il s’est distingué également par son ascétisme en se castrant lui-même. Très éprouvé par la persécution de l’empereur Dèce lancée à la fin de l’an 249 ou au début de 250, il meurt en 254 à Tyr.
Origène est en quelque sorte l’emblème de ce IIIe siècle, qui voit le christianisme s’intégrer toujours plus à la société gréco-romaine, prendre une étoffe intellectuelle, vivre dans un ascétisme rigoureux et souffrir de persécutions ponctuelles mais graves. Dans la première moitié de ce siècle, la jeune religion se développe considérablement. Vers 250, on trouve des chrétiens partout dans l’Empire romain. L’organisation de la communauté progresse.
Le catéchuménat (l’enseignement qui précède l’entrée dans l’Eglise) dure jusqu’à trois ans. Le candidat est interrogé sur ses motivations, promet de renoncer à certaines professions, comme le service militaire, et reçoit l’instruction. Le baptême fait l’objet d’un rite complexe. La question du pardon des péchés est débattue: les rigoristes estiment que les péchés ne sont pas rémissibles et impliquent l’exclusion définitive de la communauté des chrétiens, d’autres prêchent en faveur d’un temps de pénitence plus ou moins long.
De grands théologiens prennent la parole sur ce problème. Parmi eux, Tertullien, un Carthaginois né vers 160 dans une famille païenne, et converti au christianisme à la fin du IIe siècle. Il est le créateur du latin littéraire chrétien, et ouvre ainsi la voie à la théologie proprement occidentale. Il introduit un vocabulaire juridique – il parle par exemple plus volontiers de «délit» que de «péché» – qui influencera toute la théologie occidentale.
Tertullien donne une vision de Dieu qui est celle du Législateur suprême. Le Carthaginois se veut le défenseur d’un christianisme très rigide, qui exalte le martyre, la virginité, et rejette le monde païen. Pas étonnant dès lors qu’il considère les péchés graves commis après le baptême comme d’impardonnables actes de trahison et qu’il finisse par rejoindre les montanistes, réputés pour leur très grande rigueur morale. Pour les évêques, sa position est intenable. Les chrétiens côtoient des païens chaque jour, ils vivent dans un empire où le christianisme est une religion marginale, tolérée mais non acceptée. Lorsque Calliste, évêque de Rome, publie un édit en 217 admettant à la pénitence tous les péchés, Tertullien explose.
C’est qu’en cette première moitié du IIIe siècle, la vie chrétienne se caractérise encore par une rigueur et un ascétisme développés. Le célibat apparaît comme un modèle de vie plus valable que le mariage. Les femmes vierges ont rang d’honneur dans l’Eglise, l’ordre des diaconesses s’affirme. Le luxe excessif est condamné, la nourriture doit être simple, l’alcool consommé avec modération. Si les sports et les bains publics sont autorisés, à condition qu’ils ne mènent pas à la promiscuité, les spectacles sont interdits à cause des passions idolâtres qu’ils suscitent.
Le christianisme, même s’il n’a pas de statut officiel, est maintenant profondément ancré dans la société païenne. Le pouvoir romain commence à prendre peur de cette cinquième colonne, d’autant plus que de nombreux périls vont menacer l’empire au cours du IIIe siècle: barbares aux frontières, décadence interne, crise économique, etc. Ses habitants sont appelés à resserrer les rangs autour du culte impérial, principal facteur de cohésion. Or, la religion des chrétiens leur interdit de participer à ce culte. L’ère des persécutions générales contre les chrétiens s’ouvre. Elle vise l’élimination totale, sinon des chrétiens eux-mêmes, du moins du christianisme.
Le premier coup vient de l’empereur Dèce: à la fin décembre 249 ou au début janvier 250, il promulgue un édit qui oblige tous les citoyens à accomplir un geste cultuel en faveur des dieux officiels. L’empereur a ainsi trouvé un moyen infaillible pour repérer les chrétiens: les morts sont nombreux, ceux qui apostasient aussi. La pression s’amenuise pour disparaître vers 254.
Valérien, arrivé au pouvoir en 253, déclenche la seconde persécution générale en août 257. Un premier édit interdit le culte chrétien et les réunions dans les cimetières, et intime aux évêques, aux prêtres et aux diacres de sacrifier aux idoles. En 258, un second édit vient renforcer ces mesures et ordonne l’exécution des membres de la hiérarchie chrétienne qui n’ont pas rendu un culte aux dieux ainsi que la confiscation des biens des chrétiens de haute classe. L’édit est appliqué avec rigueur, la persécution sanglante.
Valérien capturé par les Perses en 260, son fils Galien met fin aux exactions et restitue leurs biens aux évêques. Les Eglises connaissent alors une période de paix qui va durer quarante ans. Cependant, comme on l’a déjà vu, les chrétiens se déchirent sur le pardon à accorder aux apostats. En Afrique, Cyprien de Carthage défend une politique de réintégration à des conditions sévères. Mais c’est encore une position trop molle aux yeux d’un groupe qu’on qualifierait aujourd’hui d’intégriste, qui fonde une Eglise schismatique.
A Rome, l’évêque Corneille rencontre le même problème. Adepte d’une politique de tolérance, il provoque la fureur de Novatien, un prêtre qui avait assuré l’intérim pendant la vacance du siège de l’évêque en 250. Un nouveau schisme s’ensuit, qui se répand dans tout l’empire. Néanmoins, les apostats repentants sont généralement réintégrés et le christianisme poursuit sa progression.
Tout à la fin du IIIe siècle, l’Orient en est très imprégné, l’Occident beaucoup moins. Les différentes Eglises locales n’ont pas de chef suprême à leur tête, elles jouissent d’une grande autonomie. Lorsqu’un problème doctrinal se présente, elles se réunissent en conciles provinciaux ou interprovinciaux pour en débattre. Les décisions sont prises en parfaite collégialité.
Pendant que les Eglises essaient de rassembler leurs forces, l’Empire romain poursuit sa décomposition. L’empereur Dioclétien, arrivé au pouvoir en 284, entreprend une restauration politique et lui imprime un virage absolutiste. Dans ce cadre, l’empereur devient l’égal des dieux. Une fois les problèmes sociopolitiques résolus, Dioclétien s’attaque au christianisme. Dans un empire devenu totalitaire, une Eglise autonome qui se rit du culte impérial devient inadmissible.
En 303, Dioclétien engage la bataille décisive contre les chrétiens. Les églises sont détruites, les livres sacrés brûlés, les assemblées chrétiennes interdites, les dirigeants de l’Eglise enfermés, les chrétiens obligés de sacrifier aux idoles, et ceux qui refusent d’apostasier torturés. Pourtant, en quelques années, la situation va se retourner complètement: le christianisme deviendra bientôt la religion d’Etat, et ce sera au tour des chrétiens de faire preuve d’intolérance envers les païens et autres hérétiques.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 202 | Septime Sévère lance une persécution. Interdiction du prosélytisme juif et chrétien |
| 226 | Début de la dynastie sassanide en Perse |
| 235 | Persécution de l’empereur Maximin |
| 242 | Début de la prédication de Mani, fondateur du manichéisme |
| 249 ou 250 | Persécution de l’empereur Dèce |
| 257 | Persécution de Valérien |
| Vers 270 | Antoine, premier anachorète au désert |
| 277 | Premières invasions barbares |
| 284 | Dioclétien au pouvoir |
| 297 | Edit de persécution contre les Manichéens |