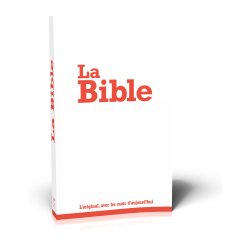Ce siècle est celui de tous les dangers pour la jeune foi, qui doit lutter contre de multiples hérésies, dont le gnosticisme et le montanisme. Politiquement, la situation des chrétiens reste précaire dans l’Empire romain.
«S’il en est ainsi, ils sont vains, ignorants, et audacieux de surcroît, ceux qui rejettent la forme sous laquelle se présente l’Evangile et qui introduisent à l’encontre soit un plus grand, soit un plus petit nombre de figures d’Evangile que celles que nous avons dites, les uns pour avoir trouvé plus que la vérité, les autres pour rejeter les «économies» de Dieu.» Irénée, né à Smyrne aux alentours de 140 et évêque de Lyon à partir de 178, écrit son livre Contre les Hérésies dans la seconde moitié du IIe siècle. Il s’avère urgent de réagir: les gnostiques n’ont cessé de conquérir de nouvelles âmes et d’introduire le trouble au sein même du christianisme, grâce à leur vision élaborée et pessimiste du monde. Car le début de ce nouveau siècle est celui de tous les dangers pour la nouvelle foi qui vient de se séparer du judaïsme. Elle ne s’apparente pas encore à une vraie religion: le corpus de ses livres saints n’est pas constitué, la communauté chrétienne, dispersée après la chute de Jérusalem et la disparition de l’Eglise de Jacques, frère du Seigneur, n’a pas trouvé de structures solides, et toutes sortes de philosophies fleurissent, plus abracadabrantes les unes que les autres.
Au début du IIe siècle, la situation des chrétiens dans l’Empire romain est précaire. On commence à les distinguer des juifs. Ils ne tombent formellement sous l’interdiction d’aucune loi, mais ils subissent l’hostilité des populations dans lesquelles ils cherchent à s’implanter, tant juives que païennes. Quelques persécutions ont lieu çà et là. Les intellectuels grecs et romains n’affectionnent guère le christianisme, qu’ils considèrent comme une religion simple destinée à soulager de pauvres gens. Pourtant, la nouvelle foi rêve d’intégration, et s’emploie à détruire les préjugés qui l’entourent. On voit alors naître un genre littéraire nouveau: les apologies. Tout comme les premiers chrétiens avaient tenté de convaincre les juifs que la foi en Jésus était l’accomplissement des Ecritures, les chrétiens du début du IIe siècle essaient de prouver que le christianisme est «le couronnement de toute la quête inspirée menée par les philosophes grecs», écrit le professeur Etienne Trocmé dans sa contribution à l’Histoire des religions publiée dans la Pléiade. Une œuvre emblématique de cette tentative qui n’aboutira pas durant ce siècle: celle de Justin de Naplouse, appelé aussi Justin Martyr, un païen converti. Il ouvre une école à Rome en 150 et écrit deux Apologies ainsi qu’un Dialogue avec le Juif Tryphon. Le pouvoir romain l’élimine dans les années 160.
Le plaidoyer de Justin en faveur de l’intégration du christianisme à la société gréco-romaine n’eut pas l’heur de plaire à tout le monde. Les Romains se moquent d’une telle tentative, et certains chrétiens ne veulent pas entendre parler d’intégration, car ils estiment que le christianisme ne doit pas se compromettre avec ce monde. Ainsi les partisans du gnosticisme, une philosophie syncrétiste née à la fin du Ier siècle, et pleinement développée vers le milieu du IIe siècle. Sous l’influence du dualisme iranien, les diverses tendances gnostiques opposent généralement Yahvé, le Dieu des juifs, un ange mauvais qui a créé le monde d’ici-bas, à un Dieu bon et caché. Certains êtres humains ont la possibilité de connaître ce Dieu bon au moyen de la gnose, la connaissance surnaturelle qui révèle aux hommes détenteurs d’une étincelle divine d’où ils viennent et où ils vont.
Une autre école inquiète les chrétiens «orthodoxes»: celle de Marcion, un homme originaire du Pont. Venu à Rome en 144. Après avoir tenté d’imposer ses idées à l’Eglise de Rome, il s’en sépare et fonde sa propre communauté. Ce schisme très grave contribuera largement à la réaction des Eglises traditionnelles. Car les doctrines de Marcion ont connu un immense succès. La recette est relativement simple: Marcion renie la Bible hébraïque qui est en train de devenir l’Ancien Testament des chrétiens, ainsi que tout ce qui, dans les textes qui formeront bientôt le Nouveau Testament, se réfère de près ou de loin au judaïsme. Le système marcionite séduit par sa simplicité et ses écritures faciles d’accès car, à la façon des gnostiques, Marcion oppose le Dieu de la Loi à celui de l’Evangile.
Un autre ennemi apparaît aux alentours de 160: Montan, qui prophétise en Phrygie (Asie mineure) un message apocalyptique et millénariste. Il rencontre également un grand succès: le montanisme réussit à pénétrer une majorité des Eglises de la région.
Face à ces dangers qui la rongent de l’intérieur, l’Eglise va réagir en se dotant enfin de théologiens dignes de ce nom, du canon des Ecritures et d’institutions solides. Les théologiens d’abord. La menace hérétique fait se lever une plume, celle d’Irénée de Lyon, qui a le mérite d’avoir le premier systématisé la foi chrétienne. Dans son livre Contre les Hérésies, il décrit les divers mouvements gnostiques pour mieux développer la vraie pensée chrétienne. On le voit: il n’existait pas d’orthodoxie chrétienne avant les hérésies, mais la grande diversité de la pensée chrétienne a amené les Eglises à préciser le contenu de la foi. A Alexandrie, où le christianisme «va achever de faire son éducation grecque en même temps que l’hellénisme achèvera d’y faire son éducation chrétienne», comme l’écrit Jean Daniélou dans son livre L’Eglise des premiers temps (Seuil, coll. Points histoire, 1985), naît la première école de théologie fondée par Pantène. Son plus célèbre représentant au IIe siècle est Clément d’Alexandrie, un philosophe contemporain d’Irénée de Lyon. A son tour il réfute les hérésies: les vérités divines ne sont pas réservées à quelques-uns; tout chrétien peut y accéder. La fin du IIe siècle voit la naissance d’un génial théologien qui sera le premier dogmaticien et qui donnera à l’exégèse sa méthode: Origène.
Le canon du Nouveau Testament ne commence à se former qu’à partir de la seconde moitié du IIe siècle. Le but des Eglises est de restituer la tradition et de remonter à l’autorité des apôtres. Dès lors, «toute tradition non apostolique va se trouver disqualifiée», écrit Etienne Trocmé. A la fin du IIe siècle, le canon commun à toutes les Eglises compte les quatre Evangiles, les Epîtres de Paul, la première Epître de Jean, la première Epître de Pierre, les Actes des Apôtres et l’Apocalypse. Certaines Eglises intègrent dans leur canon des textes que refusent d’autres. Le canon ne s’unifiera qu’au cours des siècles suivants.
Quant aux institutions, elles se renforcent considérablement au IIe siècle. La figure de l’évêque comme gardien de la doctrine et garant de l’unité s’impose partout progressivement. A la fin du IIe siècle, on reconnaît aux évêques de certaines villes importantes une prééminence sur une région entière. Ainsi en va-t-il pour les évêques de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche, de Lyon et de Carthage. Pour communiquer entre elles, les Eglises, qui fonctionnent sur un mode congrégationaliste à l’opposé du centralisme romain d’aujourd’hui, convoquent des synodes. A l’époque, l’Eglise de Rome n’apparaît pas plus importante que ses sœurs d’Orient. Elle commence néanmoins à manœuvrer pour obtenir un plus grand pouvoir.
Ainsi paré, avec des structures, des théologiens brillants et un corpus d’Ecritures saintes, le christianisme est prêt à affronter le IIIe siècle et à engager une bataille serrée avec l’Empire romain.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 117 | mort de Trajan |
| 132 | nouvelle révolte des Juifs |
| 138 | mort de l’empereur Hadrien |
| 163 | martyre de Justin à Rome |
| 170 | débuts du montanisme |
| Vers 178 | Irénée est évêque de Lyon |
| 185 | naissance d’Origène |