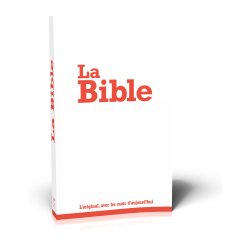Le christianisme a mis longtemps à se dégager du judaïsme. Les premiers chrétiens prêchent dans des synagogues et tentent de convertir des juifs. Paul de Tarse élargit la prédication aux païens, et amorce ainsi une séparation définitive, qui ne sera effective qu’au IIe siècle.
Dans l’après-midi de ce jour d’avril, au début des années 30 de notre ère, un homme du nom de Jésus expire sur une croix à Jérusalem. Cette mort a un goût amer pour ceux qui ont cru en lui. Elle représente l’échec d’une espérance qui les a nourris durant les trois années de la prédication de ce Jésus de Nazareth qu’ils ont suivi aveuglément sur les routes de Palestine. Mais voilà qu’il n’est plus, et que le rêve s’écroule. Maintenant, ses disciples doivent se cacher, de peur d’être arrêtés par les Romains, qui n’aiment pas les agitateurs juifs.
Pourtant, en quelques mois, ils vont retrouver leur confiance, se montrer et annoncer la résurrection de leur maître. Pour le croyant, ce retournement total de situation va de soi. Après sa mort, Jésus s’est fait voir à ses disciples, nous apprennent les Evangiles, les a exhortés à poursuivre l’œuvre commencée et à annoncer sa victoire sur la mort. L’historien ou le non-croyant ne peuvent que constater que d’une situation désespérée est née peu à peu une secte qui allait prendre de l’ampleur et devenir la religion que l’on sait.
Pourtant, le christianisme a mis longtemps à se séparer du judaïsme, la religion dont il est issu. A l’époque de Jésus, le judaïsme apparaît très diversifié et plusieurs groupes – comme les sadducéens, les pharisiens, les esséniens et les zélotes – dialoguent entre eux, se méprisent ou s’ignorent. Il n’est donc pas étonnant que Jésus réunisse autour de lui des foules pour parler de sa vision de Dieu et de la Torah.
Aussi, au début de leur évangélisation, les apôtres et leurs disciples cherchent-ils à convaincre leur entourage qu’en Jésus se réalisait ce qu’annonçaient les Ecritures: que la venue du Nazaréen représentait l’accomplissement de l’attente eschatologique qui marquait l’esprit des juifs opprimés depuis deux siècles par des puissances étrangères.
Les premiers chrétiens ne se distinguent d’ailleurs pas des autres juifs, vont prier au Temple de Jérusalem, ville dans laquelle ils ont décidé de rester pour prêcher la bonne nouvelle, et font leurs dévotions comme tout le monde. Bien entendu, ils ont aussi des rites et une catéchèse propres. Pierre est leur chef. L’Eglise de Jérusalem prend forme, et les premiers conflits viennent bientôt diviser la petite communauté.
Contrairement aux apôtres, les hellénistes, des juifs de langue grecque venus de la diaspora, ont une conception offensive de l’évangélisation, et s’attaquent à l’autorité du Temple. Mal leur en prend: Etienne, un de leurs chefs, est lynché, sans doute avant l’an 35. Chassés de Jérusalem, les hellénistes se dispersent. Mais ils ne resteront pas inactifs: ils fonderont des communautés à Antioche, à Chypre, en Phénicie, à Damas. Ils seront les premiers à annoncer la bonne nouvelle aux païens.
En attendant, Paul de Tarse, un Juif né en Cilicie (Turquie actuelle) et doté de la nationalité romaine, se réjouit de cette déroute. Très attaché à la Torah et au Temple, il voue une haine féroce à ceux de ses compatriotes qui cèdent aux sirènes chrétiennes, et il n’hésite pas à supprimer ces hérétiques de manière forte.
Un jour, alors qu’il galope sur le chemin de Damas pour y disperser une communauté chrétienne récemment implantée, Jésus lui apparaît (…) et l’on ne sait pas grand-chose de la conversion de ce persécuteur, qui a sans doute eu lieu peu après le martyre d’Etienne. Quoi qu’il en soit, Paul va désormais employer son zèle au service de l’Evangile, avec la bénédiction de l’Eglise de Jérusalem.
Avec Barnabé, son collègue de Jérusalem, il fonde plusieurs églises en Asie mineure dans les années 40. Tous deux se rendent d’abord dans les synagogues, où ils tentent de convertir les Juifs. Mission difficile, voire impossible: les deux larrons sont parfois menacés et malmenés. Ils commencent alors à enseigner également aux païens et rencontrent un grand succès, qui les incite à lâcher du lest quant à l’obligation pour les convertis de se faire circoncire.
De retour à Antioche après ces premiers voyages, Paul et Barnabé sont confrontés à l’arrivée dans cette ville de chrétiens de Jérusalem (les judéo-chrétiens) qui proclament la nécessité de la circoncision en vue du salut. Le conflit est porté devant l’Eglise de Jérusalem, qui jouit d’une grande autorité. Jacques, frère du Seigneur, apparaît à cette époque comme le chef charismatique et incontesté de cette Eglise. Au cours de ce premier concile, qui se tient aux alentours de l’an 49, Jacques, Pierre et Jean donnent raison aux deux missionnaires sur la question de la circoncision. Les païens ne sont tenus qu’au respect de quelques principes. C’est la première rupture avec la communauté juive, le premier signe d’indépendance de la religion qui est en train de naître.
Paul et Barnabé, forts de cette victoire, s’en retournent à Antioche. Peu après, Pierre se rend dans cette ville. Au début de son séjour, il mange avec les pagano-chrétiens comme avec les judéo-chrétiens. Mais, lorsque des gens de l’entourage de Jacques le rejoignent, il ne partage plus ses repas avec les premiers, et Barnabé le suit. Paul écume de rage: ainsi donc, il y a deux catégories de chrétiens pour l’Eglise de Jérusalem, dont une est inférieure à l’autre. Aux yeux de Paul, seule la foi dans le Christ sauve l’homme, et certainement pas l’obéissance à la Loi de Moïse. Dès lors, Paul rompt avec Jérusalem et poursuit seul sa mission, qui l’amènera à fonder plusieurs églises. De leur côté, les judéo-chrétiens apportent aussi l’évangile dans de nouvelles contrées.
Dans les années 60, une série d’événements mettent en danger le christianisme naissant: en 62, Jacques meurt. En 64, Néron déclenche à Rome des persécutions contre les chrétiens, qui ne sont pas encore très organisés dans cette ville. Pierre et Paul y trouvent la mort. En l’an 70, c’est le drame, tant pour les Juifs que pour la foi nouvelle: la révolte juive contre l’occupant romain, commencée en 66, aboutit à la chute de Jérusalem et à la destruction du Temple par les armées de Titus. L’Eglise de Jérusalem perd toute importance, les chrétiens n’ont plus de centre de référence, et la dispersion menace.
Quant aux Juifs, ils serrent les rangs autour de l’école pharisienne de Jamnia. Celle-ci a imposé le judaïsme rabbinique qui a survécu jusqu’à nos jours. Aux alentours de l’an 90, cette école rejette les autres mouvements juifs pour en faire des hérésies. Les judéo-chrétiens se trouvent ainsi définitivement éliminés de la carte du judaïsme. Mais dans les consciences, la rupture se fait plus lentement. Les documents manquent pour reconstituer les événements qui ont amené les chrétiens à trouver leur identité propre après le drame de l’an 70.
Selon Etienne Trocmé, professeur émérite à l’Université de Strasbourg, la littérature chrétienne du Ier siècle donne pourtant à penser que dès l’an 100, la conscience de cette identité existe. Il faudra cependant attendre le milieu du IIe siècle avant de voir la naissance d’une véritable théologie chrétienne. Jusque-là, le christianisme représente plus un mode de vie qu’une religion stricto sensu.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| Entre -6 et -4 | Naissance de Jésus de Nazareth |
| -4 | Mort du roi Hérode le Grand |
| Vers 27-30 | Prédication de Jésus en Judée et en Galilée |
| Avril 30 ou avril 33 | Mort de Jésus |
| Vers 35-36 | Martyre d’Etienne, persécution contre les hellénistes |
| Vers 37 | Conversion de Paul |
| Vers 49-50 | Premier concile de Jérusalem. La circoncision n’est plus obligatoire pour les païens convertis |
| 58 | Arrestation de Paul |
| 62 | Martyre de Jacques, frère du Seigneur et chef de l’Eglise de Jérusalem |
| 64 | Persécution de Néron contre les chrétiens |
| Entre 64 et 68 | Mort de Pierre et de Paul à Rome |
| 66-70 | Insurrection juive contre l’occupant romain |
| 70 | Chute de Jérusalem, destruction du Temple |
| 70-80 | Rédaction finale des Evangiles selon Marc et selon Matthieu |
| 90-100 | Rédaction finale des Evangiles selon Luc et selon Jean |