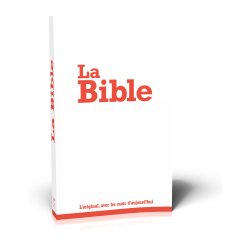Le christianisme occidental entame un lent déclin qui conduira à la Réforme deux siècles plus tard. La papauté, exilée à Avignon pendant une soixantaine d’années, est plus préoccupée d’argent et de pouvoir que de spiritualité. Elle offre un spectacle affligeant. Sa division engendre un schisme de quarante ans. Des voix toujours plus nombreuses contestent l’institution ecclésiale et pontificale.
«Je prétends que l’individu en question, surnommé Boniface, n’est pas un pape. Il n’est pas entré par la porte, on doit le considérer comme un voleur et un brigand. Je prétends que ledit Boniface est un hérétique manifeste et un horrible simoniaque, comme il n’y en a pas eu depuis le commencement du monde. Je prétends encore que ledit Boniface a commis des crimes manifestes, énormes, en nombre infini, et qu’il est incorrigible. Il appartient à un concile général de le juger et de le condamner.»
Cet acte d’accusation à l’encontre du pape Boniface VIII est signé Guillaume de Nogaret, légiste du roi de France Philippe le Bel. Il date de 1303, année durant laquelle Guillaume de Nogaret est allé menacer le pape dans sa résidence à Anagni, et exprime fort bien le tournant radical qui s’amorce dans les relations Eglise-Etat en ce XIVe siècle.
En 1302, Boniface VIII, lassé par la résistance que lui opposait Philippe le Bel sur les questions de l’immunité fiscale de l’Eglise et de l’immunité judiciaire des clercs, avait publié la bulle Unam Sanctam, laquelle reprenait les prétentions théocratiques de ses prédécesseurs. Mais c’était en vain que Boniface VIII s’agitait: l’époque d’Innocent III était bel et bien terminée. La montée en puissance de l’idée nationale et des monarchies avait imposé un coup d’arrêt à la théocratie. En 1297 déjà, Philippe le Bel avait défini en ces termes sa conception du pouvoir temporel: «La direction de la temporalité du royaume appartient au seul roi et à personne d’autre, et celui n’a et ne reconnaît aucun supérieur et n’a pas l’intention de se soumettre et de s’astreindre à quiconque pour tout ce qui concerne le temporel de son royaume.»
En 1305, l’archevêque de Bordeaux Bertrand de Got prend la succession de Boniface VIII, sous le nom de Clément V. Il se rend à Avignon pour discuter avec Philippe le Bel. La préparation d’un concile le retient encore quelque temps dans cette cité, puis des facteurs politiques l’empêchent de se rendre à Rome. L’empereur Henri VII a envahi l’Italie et des troubles politiques agitent les Etats pontificaux. Face à l’hostilité de l’Empire et de l’Italie et fort du soutien de la France, Clément V choisit de rester à Avignon. Durant son séjour dans cette ville, qui dura de 1309 à 1377, la papauté perdit une grande partie de son crédit aux yeux des chrétiens du XIVe siècle.
Pour nous en rendre compte, lisons ces quelques lignes du poète Pétrarque (1304-1374), celui-là même qui a chanté ses amours avec Laure: «Avignon, c’est l’impie Babylone, l’enfer des vivants, la sentine des vices, l’égout de la terre. On n’y trouve ni foi, ni charité, ni religion, ni crainte de Dieu, ni pudeur, rien de vrai, rien de saint: quoique la résidence du souverain pontife en dût faire un sanctuaire et le fort de la religion […]. De toutes les villes que je connais, c’est la plus puante […]. Les cardinaux: […] A la place des Apôtres qui allaient nu-pieds, on voit à présent des satrapes montés sur des chevaux couverts d’or, rongeant l’or et bientôt chaussés d’or, si Dieu ne réprime leur luxe insolent. On les prendrait pour des rois de Perse ou des Parthes qu’il faut adorer, et qu’on n’oserait aborder les mains vides.»
Le luxe et la richesse dans lesquels se vautrent avec délices les cardinaux assoiffés de pouvoir et la cour du pape, qui compte quelques milliers d’hommes, exaspèrent plus d’un chrétien. Le souverain pontife lui-même mène souvent la vie fastueuse d’un prince laïc. Pourtant, quelques papes avignonnais très pieux refusèrent de céder aux sirènes du monde, comme Benoît XII (1334-1342), Urbain V (1362-1370) et Grégoire XI (1370-1378). Clément V est à la solde de Philippe le Bel et accepte de condamner et de supprimer l’Ordre des Templiers.
Jean XXII (1316-1334) développe l’administration et la cour pontificales. Les impôts augmentent et deviennent vite excessifs. Ils sont prélevés par des percepteurs pontificaux avides et impitoyables, qui ont recours à des mesures de coercition comme les amendes, la censure et l’excommunication. Au total, écrit Jacques Le Goff, «les papes étaient au quatrième rang des revenus princiers de la Chrétienté, après les rois de France, d’Angleterre et de Naples». L’utilisation égoïste de cet argent ne pouvait qu’exacerber les colères et jeter l’opprobre sur Avignon. Comme le note l’historien David Knowles, «la plus grande partie de ces immenses revenus allait à l’entretien de la cour pontificale ou était donnée en aumônes, présents et largesses diverses».
C’est dans ce contexte que se font entendre pour la première fois des voix critiques aux accents laïcs. Marsile de Padoue (1274-1342), ancien recteur de l’Université de Paris, prend le parti du roi Louis de Bavière dans le conflit qui l’oppose au pape Jean XXII. Ce dernier exigeait une soumission inconditionnelle du roi, qui répliqua en nommant un antipape. Marsile de Padoue expose ses idées dans un texte nommé Defensor Pacis, publié en 1324. A ses yeux, la papauté était une institution purement humaine, qui n’avait pas à s’ingérer dans la vie civile, du seul ressort du prince. Son contemporain Guillaume d’Occam (1290-1350), un franciscain anglais qui a lui aussi pris le parti de Louis de Bavière contre Jean XXII, lance une violente polémique contre la papauté et l’Eglise, dont il remet en question l’institution divine et l’infaillibilité. Selon lui, l’Eglise est la communauté des fidèles et non celle des prêtres.
Le Grand Schisme qui a suivi le retour des papes à Rome ne fit que confirmer dans leurs opinions les penseurs qui contestaient la papauté et réclamaient un retour à l’autorité des seules Ecritures, comme l’Anglais John Wyclif et le Pragois Jan Hus. En 1377, sensible aux conseils de Catherine de Sienne, le pape Grégoire XI met fin à l’exil d’Avignon et transfère la Curie à Rome. Il meurt peu après. Apparemment sous la pression du peuple qui exige un pape romain ou italien, les cardinaux élisent en avril 1378 Bartolomeo Prignano, archevêque de Bari. Il prend le nom d’Urbain VI et se révèle rapidement être un despote brutal et autoritaire. Scandalisés, les cardinaux reviennent sur leur décision et choisissent de nommer Robert de Genève à la fonction pontificale. Mais Urbain VI refuse d’abdiquer.
Le nouveau pape prend le nom de Clément VII et part pour Avignon en 1379. L’Europe se divise en deux camps. Les partisans d’Urbain VI: l’Empire, la Bohême, les Flandres, les Pays-Bas, la Castille. Ceux de Clément VII: la France, l’Ecosse, la Savoie, l’Autriche, l’Aragon et la Navarre. Pendant quarante ans, les papes des deux camps s’invectivèrent et s’excommunièrent mutuellement, et cherchèrent à régler le conflit par la violence. Celui-ci ne prit fin qu’en 1417, lors du concile de Constance.
Le lamentable spectacle qu’offrait le Grand Schisme encouragea sans doute John Wyclif et Jan Hus à propager leurs thèses. Le premier attaqua violemment la papauté, le sacerdoce, les ordres religieux et nia la transsubstantiation et la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Le second reconnut l’Eglise hiérarchique, mais, influencé par les idées de Wyclif, voyait dans l’Ecriture la seule base de la foi. Le concile de Constance le condamna et il mourut sur le bûcher en 1415.
Sur fond de Grande Peste et de guerre de Cent Ans, la religiosité populaire s’ancre souvent dans une superstition pathologique. On voit Satan et ses agents partout. La chasse aux sorciers et, surtout, aux sorcières, commence. Les juifs, une fois de plus, servent souvent de victimes expiatoires aux malheurs du temps, qu’on attribue à la colère de Dieu. Les gens ont peur de mourir, les indulgences se multiplient. Le monde monastique souffre aussi du relâchement général. Mais ces sombres manifestations ne sauraient faire oublier l’authentique recherche spirituelle de nombreux chrétiens, comme celle des mystiques rhénans, dont maître Eckhart, Tauler et Ruysbroek ont été les plus beaux fleurons au XIVe siècle. Ce qu’on appelle la dévotion moderne, dont L’Imitation de Jésus-Christ est l’ouvrage le plus célèbre, apparaît à ce moment.
Tandis que la spiritualité occidentale périclite d’une manière générale, l’Orient assiste à un renouveau du monachisme érémitique et cénobitique. L’hésychasme, cette prière contemplative qui vise à atteindre la paix intérieure par la répétition fréquente d’une phrase («Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi») et des exercices corporels, se répand largement. L’archevêque de Thessalonique Grégoire Palamas (1296-1359) lui donne ses lettres de noblesse en l’incorporant à la théologie de l’Eglise orthodoxe.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 1303 | Mort du pape Boniface VIII |
| 1307-1312 | Destruction de l’Ordre des Templiers |
| 1308 | Mort de Duns Scot |
| 1309-1378 | Les papes en Avignon |
| 1321 | Mort de Dante |
| 1327 | Mort de maître Eckhart |
| 1337 | Début de la guerre de Cent Ans |
| 1348-1349 | Première épidémie de la peste noire |
| 1349 | Mort de Guillaume d’Occam |
| 1357 | Les Turcs prennent Andrinople |
| 1374 | Mort de Pétrarque |
| 1378-1417 | Grand Schisme |
| 1384 | Mort de John Wyclif |
| 1386 | Les Suisses battent les Autrichien à Sempach |
| 1389 | Les Turcs battent les Serbes à la bataille de Kosovo Polje |