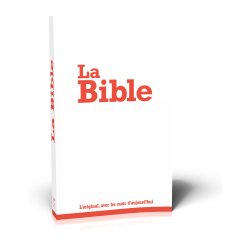La sécularisation avance, la société occidentale entre dans la modernité. Les découvertes scientifiques et la philosophie évacuent Dieu du monde et de la pensée. Tandis que les protestants essaient de concilier ce monde nouveau avec le christianisme, les catholiques se replient sur le passé.
A l’aube du XIXe siècle, en 1799, le théologien protestant allemand Friedrich Schleiermacher publie ses Discours sur la religion. Ses thèses enflamment rapidement les esprits asséchés par le rationalisme tout-puissant du 18e siècle. Elevé dans la tradition piétiste, il affirme que la religion «n’est ni pensée, ni action, mais contemplation intuitive et sentiment.» Partant de ce principe, il tente de dégager le christianisme de sa gangue métaphysique, éthique et spéculative. Selon lui, le sentiment religieux est une expérience personnelle qui se traduit par la dépendance absolue à l’égard de Dieu et l’intuition de l’infini. Il est purement subjectif et ne souffre aucune intervention de la raison.
Dans ce cadre, les dogmes ne constituent plus des vérités objectives, mais des créations historiques, qui peuvent néanmoins servir à nourrir la piété. Avec ses théories, Schleiermacher, dont la stature a dominé tout le XIXe siècle, a ouvert une nouvelle ère dans la pensée protestante. «Il a fondé moins une école qu’une époque», a dit de lui le grand théologien bâlois Karl Barth (1886-1968). Friedrich Schleiermacher est en effet considéré comme le père du libéralisme, ce mouvement qui a cherché à concilier le christianisme avec les découvertes scientifiques, exégétiques et philosophiques du XIXe siècle. Pour ce théologien, la religion, cantonnée dans l’espace du sentiment et libérée de ses prétentions rationnelles, ne pouvait en effet être l’ennemie de la modernité.
Au XIXe siècle, la théologie protestante allemande connaît un formidable développement dans l’esprit du libéralisme. Après Schleiermacher, d’autres penseurs prestigieux émergent, qui veulent donner au sentiment religieux une base rationnelle susceptible d’épouser les contours de la modernité naissante. Ils soumettent l’Ancien et le Nouveau Testament à la critique historique. Le résultat de ces recherches aboutit à un tremblement de terre: la publication, en 1835, de la Vie de Jésus par le théologien de Tübingen David Friedrich Strauss. Selon lui, les évangiles n’ont aucun fondement historique et relèvent de la mythologie. A la fin de sa vie, sa pensée se fera encore plus radicale: il affirmera en effet que la Résurrection est une mystification à l’échelle mondiale.
Ferdinand Christian Baur, maître de Strauss, propose une approche hégélienne des évangiles, avec une thèse, une antithèse et une synthèse. A la fin du XIXe siècle, l’historien de l’Eglise Adolf Harnack décape le message chrétien, qui est à ses yeux enfoui sous une couche dogmatique et doctrinale, pour lui redonner sa simplicité originelle. Selon lui, le dogme chrétien est une construction de la métaphysique grecque plaquée au cours des siècles sur les paroles simples de Jésus.
Le protestantisme du XIXe siècle a également bénéficié d’un renouveau de la vie religieuse appelé Réveil. Ce mouvement d’inspiration piétiste, véritable réaction contre le rationalisme, est plus tourné vers l’action que vers la pensée. Il est à l’origine de l’exceptionnelle expansion de la mission protestante et de la prolifération des œuvres sociales qui caractérise l’époque. Mettant l’accent sur la repentance et la conversion, il s’est propagé avec succès dans tous les pays protestants, de la Grande-Bretagne à l’Amérique du Nord en passant par l’Europe.
Face à ce foisonnement de la théologie protestante, les catholiques, quoique stimulés par leurs contemporains protestants, se montrent beaucoup moins audacieux. Peu de grands penseurs se signalent dans cette période. Seuls quelques théologiens allemands, comme Johann-Adam Möhler, Joseph Görres et Ignace Döllinger, brilleront réellement dans la constellation catholique du XIXe siècle. Il faut dire que l’Eglise est tout occupée à rétablir son autorité considérablement ébranlée par la Révolution française et ses conséquences. Dans certains pays, comme en France, les structures de l’enseignement théologique – les universités, les abbayes et les séminaires – ont disparu. Tout est à reconstruire.
De plus, le pape a perdu toute influence temporelle. Il aura beau protester contre la réorganisation de l’Europe issue du Congrès de Vienne en 1815, les grandes puissances resteront sourdes à ses appels à la restauration de l’ordre ancien. Pourtant, la perte de son pouvoir temporel redonnera à la papauté un immense prestige spirituel qui se traduira par un attachement fervent à la personne du pontife romain. Ainsi, Pie IX sera considéré par certains comme «Vice-Dieu».
L’heure est donc à la défense du catholicisme, menacé par le libéralisme, le relativisme, les progrès scientifiques, la démocratie, l’athéisme et le socialisme. En France, Louis de Bonald, Joseph de Maistre et Félicité de Lamennais se font les champions de l’ultramontanisme, une théorie qui prône une Eglise forte, centralisée, et dominée par le pape, seul garant de l’ordre social. C’est à Lamennais que l’on doit cette phrase célèbre: «Sans pape, point d’Eglise; sans Eglise, point de christianisme; sans christianisme, point de religion et point de société.»
Lamennais deviendra peu à peu favorable au libéralisme, allant jusqu’à préconiser une séparation totale de l’Eglise et de l’Etat, sans pour autant abandonner ses thèses ultramontaines. Ses idées inquiéteront le pape Grégoire XVI, qui les condamnera implicitement en 1832 dans l’encyclique Mirari vos. Déçu, Lamennais quittera l’Eglise.
La crainte du modernisme suscite une réaction autoritaire tant à la base qu’au sommet de l’Eglise. A la base, les fidèles catholiques sont le plus souvent ultraconservateurs, voire réactionnaires, et considèrent le socialisme et les progrès scientifiques avec une méfiance haineuse. Certains d’entre eux sont pourtant séduits par le libéralisme. Au sommet, le pape Pie IX conduit l’Eglise vers la centralisation et l’infaillibilité pontificale. Premier acte: la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception en 1854. Le pape se donne la liberté de définir lui-même un article de foi qui ne se trouve pas explicitement dans l’Ecriture, ce qui présuppose son infaillibilité de fait.
Deuxième acte: le 8 décembre 1864, Pie IX publie simultanément l’encyclique Quanta Cura et le Syllabus, une liste de 80 erreurs modernes. Il condamne le libéralisme sous toutes ses formes et donc la civilisation moderne. Peu avant, le 20 juin de la même année, il avait mis à l’Index nombre de romans célèbres, comme Madame Bovary de Gustave Flaubert ou Les Misérables de Victor Hugo, ainsi que les œuvres d’Emile Zola et d’Honoré de Balzac.
Le souverain pontife a de quoi avoir peur. Politiquement, il a perdu en 1861 la grande majorité des Etats pontificaux. Seules les troupes de Napoléon III empêchent le roi du Piémont Victor-Emmanuel de s’emparer de Rome. Au plan intellectuel, la pensée athée tire à boulets rouges sur le christianisme. Dans les années 1820, Auguste Comte, père du positivisme, a affirmé que la religion est condamnée à disparaître avec l’avènement du stade positif de l’humanité, celui où les hommes renoncent à chercher l’essence des choses pour se concentrer sur la découverte des lois qui régissent l’univers par l’observation et le raisonnement.
En 1841, Ludwig Feuerbach a publié L’Essence du christianisme et dénoncé dans cette religion une illusion et une projection des aspirations humaines à la perfection. En 1844, Arthur Schopenhauer a réactualisé son œuvre Le Monde comme volonté de représentation, qui présente le christianisme comme une faiblesse de l’esprit. En février 1848, Marx et Engels ont publié Le Manifeste du Parti communiste, qui annonce la disparition de la religion. En 1859, Charles Darwin, dans son ouvrage De l’Origine des espèces, défend la théorie selon laquelle l’homme est issu d’une longue évolution et non d’un acte de création divine.
Le troisième acte de la réaction autoritaire de Rome est le premier concile du Vatican (1869-1870), qui consacre le dogme de l’infaillibilité du pape ainsi que la primauté du pontife romain. Certains évêques refusent les résultats du concile et fondent une Eglise schismatique, celle dite «vieille catholique» ou «catholique chrétienne».
La lutte de l’Eglise contre le modernisme connaîtra une phase aiguë au tout début du XXe siècle, avec le pontificat de Pie X. Mais c’est peine perdue: tout au long du XIXe siècle, la sécularisation a gagné du terrain et le religieux perdu son emprise sur l’existence quotidienne des hommes. Dans certains pays, des législations anticléricales apparaissent. Ainsi le Kulturkampf en Allemagne, qui démarre en 1871. En France, la laïcité s’étend, et la séparation de l’Etat et de l’Eglise sera proclamée en 1905.
Il serait injuste de réduire le catholicisme de la fin du XIXe siècle à ses réactions de repli. Avec le pape Léon XIII (1878-1903), un véritable souci d’ouverture sur le monde moderne fait son apparition. Le souverain pontife s’inquiète notamment de la misère dans laquelle vivent les ouvriers et condamne la concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns dans son encyclique Rerum Novarum. C’est la naissance de la doctrine sociale de l’Eglise.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 1806 | Dissolution du Saint Empire romain germanique |
| 1809 | Napoléon rattache les Etats pontificaux et Rome à la France |
| 1814 | Le pape Pie VII rétablit l’ordre des jésuites |
| 1815 | Fondation de la première société missionnaire protestante à Bâle |
| 1830 | Joseph Smith fonde l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours (mormons) |
| 1863 | Ernest Renan publie la Vie de Jésus |
| 1870 | Le roi d’Italie Victor-Emmanuel s’empare de Rome |
| 1873 | Naissance de l’Eglise vieille-catholique |
| 1878 | Création de l’Armée du Salut |
| 1883 | Fin du Kulturkampf, lancé en Allemagne en 1871 |
| 1894 | Début de l’affaire Dreyfus |
| 1895 | Théodore Herzl développe le concept de sionisme dans son livre L’Etat juif |