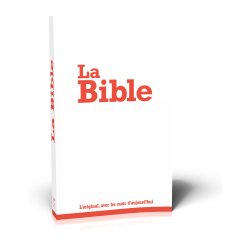Au XVIe siècle, les catholiques ne sont pas restés inactifs face à la Réforme. Le concile de Trente a enfin pris les mesures qui s’imposaient pour revitaliser une Eglise en perte de vitesse. Les fruits de cette réforme s’épanouissent au XVIIe siècle. Le renouveau touche tous les aspects de la vie religieuse.
Au début du XVIe siècle, le déclin de l’Eglise romaine avait suscité quelques tentatives de réforme. Elles provenaient essentiellement de la base. Mais elles s’avéraient trop dispersées pour aboutir à un quelconque mouvement d’envergure. L’idée du concile commença à s’imposer avec force, malgré la résistance des papes. En 1542, Paul III se décida enfin à convoquer l’assemblée œcuménique à Trente, dans le Haut-Adige. Elle s’ouvrit en 1545, fut interrompue à plusieurs reprises, et prit fin en 1563.
Son œuvre fut immense. «A aucun moment de l’histoire de l’Eglise, un concile n’assuma un programme doctrinal et pastoral aussi total», remarque l’historien René Taveneaux. Des réformes furent promulguées dans tous les domaines, les dogmes définis avec soin, la réflexion théologique sur la question du salut travaillée en profondeur. L’assemblée tridentine ne marqua cependant pas une rupture. Si elle a concrétisé le passage à la catholicité, elle a coordonné et canalisé pour l’essentiel les velléités de réformes qui existaient déjà. Aux yeux des historiens, la question de savoir si Trente a procédé d’une volonté de Contre-Réforme ou d’une volonté de Réforme catholique est vaine, tant les deux aspects s’entrelacent au XVIe siècle.
La mise en œuvre des décisions conciliaires fut une entreprise de longue haleine. Elle a porté ses fruits surtout au XVIIe siècle. Elle dépendait pour beaucoup de la bonne volonté des souverains des nations catholiques, qui ne voyaient pas toujours d’un bon œil les prétentions temporelles de la monarchie pontificale. Ainsi la France refusa-t-elle d’intégrer les canons du concile. Pourtant, la réforme tridentine pénétra peu à peu dans la vie de l’Eglise, grâce à l’action des papes et de quelques grands personnages.
En 1566, Pie V (1566-1572) publie le Catéchisme romain destiné aux prêtres. Suivront le Bréviaire romain (1568), le Missel romain (1570), le Cérémonial des évêques (1600) et le Rituel romain (1614). Grégoire XIII (1572-1585), à qui l’on doit notre actuel calendrier grégorien, fonde séminaires et collèges, dont l’Université grégorienne. Sixte Quint (1585-1590) réforme la curie: il établit 18 congrégations ou ministères destinés à aider le pape dans le gouvernement de l’Eglise et fixe le nombre des cardinaux du Sacré Collège à 70. L’action des papes impressionne les catholiques et contribue à développer une dévotion à l’égard du Saint-Siège.
Peu à peu, la réforme touche tous les domaines de la vie ecclésiastique. Charles Borromée (1538-1584), archevêque de Milan, est considéré comme l’homme qui a «refait l’épiscopat d’Europe». Le choix des évêques se fait selon des exigences plus strictes et l’épiscopat atteint bientôt une qualité spirituelle très élevée, surtout au XVIIe siècle. L’évêque, de grand seigneur qu’il était, passe au statut de chef religieux. Au XVIe siècle, les prêtres étaient encore incultes pour la plupart, et souvent dépravés. Grâce à la fondation et à l’essor des séminaires, ils reçoivent enfin une instruction religieuse adéquate. Le concept de vocation fait son apparition. Les candidats au sacerdoce doivent montrer des prédispositions morales pour la vie religieuse et passer par l’étape du noviciat. Quant au peuple chrétien, il est mieux instruit grâce au catéchisme. Au XVIIe siècle, les manuels de catéchisme seront distribués à tous les enfants.
Le renouveau touche également les ordres, dont la discipline s’était fortement relâchée au cours du XVe siècle. Ils se regroupent en congrégations. En Espagne, Thérèse d’Avila réforme le Carmel en 1562, aidée par Jean de la Croix. Ignace de Loyola, un ancien officier, fonde la Compagnie de Jésus, qu’il met au service du pape. L’auteur des Exercices spirituels voue les jésuites à l’éducation, à la mission, à la défense de l’Eglise catholique.
Leurs succès sont rapides et la Compagnie s’étend: de 5000 membres en 1581, ses effectifs passent à 16 000 en 1625. D’autres ordres religieux connaissent un prodigieux développement. Les capucins, créés en 1526, comptent 20 000 âmes au début du XVIIe siècle. La réforme catholique atteint aussi les couvents de femmes, mais dans une moindre mesure. Les religieuses n’ont pas le droit d’enseigner ou de partir en mission comme les hommes.
Après les structures, les âmes: la spiritualité est une des grandes bénéficiaires du renouveau catholique. «L’Ecole française» – ainsi appelle-t-on le grand courant spirituel qui a dominé la première moitié du XVIIe siècle – a donné au catholicisme de l’époque quelques-unes de ses figures les plus marquantes. François de Sales, évêque de Genève résidant à Annecy, conçoit une spiritualité à l’usage des laïcs, accessible aux plus humbles. Il publie en 1609 l’Introduction à la vie dévote, son ouvrage le plus connu. L’élan donné par François de Sales (1567-1622) trouve des prolongements dans l’action de son contemporain Pierre de Bérulle (1575-1629), fondateur d’une compagnie de prêtres appelée l’Oratoire. Selon ce dernier, le chrétien doit tenter de modeler sa vie sur celle du Christ.
Bérulle introduit aussi en France le carmel réformé avec l’aide de Madame Acarie. L’exemple de ces deux religieux suscitera un fort courant mystique dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dont une des expressions sera le quiétisme, représenté notamment par Jeanne Guyon et Fénelon. Certains historiens parleront d’invasion mystique. Vincent de Paul (1581-1660) incarne le souci des pauvres et des démunis, qui prend une nouvelle dimension avec la naissance du capitalisme, la montée de la bourgeoisie et la croissance des villes. Il fonde la Congrégation de la Mission ou Lazaristes, destinée à l’évangélisation des campagnes, et les Filles de la Charité.
La théologie élargit son champ. L’exégèse, née au XVIe siècle, consolide son assise. Sous la plume de l’oratorien français Richard Simon, elle se fait critique. Simon est un des premiers à démontrer que le Pentateuque ne peut être l’œuvre du seul Moïse. Mais sa méthode exégétique est considérée comme dangereuse pour la foi. Bossuet la condamne. Le XVIIe siècle voit naître les premiers conflits entre religion et science. En 1600, Giordano Bruno est brûlé pour avoir développé l’héliocentrisme copernicien. Quant à Galilée, il termine sa vie en résidence surveillée après avoir subi deux procès.
L’extension de la réforme catholique ne va pas sans crises ni conflits. L’un des plus importants a trait au jansénisme. Cette doctrine, élaborée par Jansénius, offre une vision pessimiste de l’homme déchu par le péché originel. Seule une vie austère visant à la sainteté peut permettre à l’homme de se sauver. Les jansénistes, dont le fief se trouve à Port-Royal, dérangent Rome par leur esprit d’indépendance et leur méfiance envers la hiérarchie ecclésiastique. Ils seront condamnés en 1713 par la bulle Unigenitus du pape Clément XI.
Les décisions du concile de Trente sont entrées en vigueur peu à peu. Mais certains pays se sont opposés fermement à toute ingérence romaine dans la vie de leur Eglise. Ainsi la France, où l’absolutisme royal ne tolère aucun contre-pouvoir. Le monarque est aussi le chef de l’Eglise. Cette attitude débouchera sur le gallicanisme, qui affirme la supériorité du concile sur le pape et conteste l’infaillibilité de ce dernier, et sur la volonté d’éliminer le protestantisme en France. Louis XIV décide en effet de restaurer l’unité religieuse de son royaume, en partie par calcul politique. Il discrimine les protestants pour les obliger à se convertir au catholicisme. En 1685, il révoque l’Edit de Nantes. Nombre de protestants quittent la France pour les pays du Nord.
Au XVIIe siècle, le protestantisme s’est consolidé et développé. En 1620, les Pères pèlerins, des puritains anglais radicaux qui s’opposent à la monarchie et préconisent l’organisation de l’Eglise selon des principes démocratiques, débarquent sur les côtes américaines pour réaliser leurs rêves. Ils seront suivis par les Quakers, mouvement né en Angleterre dans les années 1640, et par les méthodistes au XVIIIe siècle.
Ces deux mouvements relèvent d’un protestantisme où l’émotion et la sensibilité sont remises en valeur. En effet, les diverses orthodoxies doctrinales protestantes avaient eu tendance à trop rationaliser la foi et à la figer dans l’institution. La revalorisation de la piété affective et sentimentale trouvera au XVIIe siècle son expression la plus célèbre dans le piétisme, fondé en 1675 par Philippe-Jacques Spener, un pasteur luthérien alsacien.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 1600 | Giordano Bruno brûle sur le bûcher |
| 1609 | Les Pays-Bas septentrionaux deviennent calvinistes |
| 1616 | Premier procès de Galilée |
| 1618 | Défenestration de Prague et début de la guerre de Trente Ans |
| 1626 | Dédicace de Saint-Pierre de Rome |
| 1633 | Second procès de Galilée |
| 1637 | Descartes publie le Discours de la méthode |
| 1643 | Début du règne de Louis XIV |
| 1647 | Promulgation de la confession de Westminster |
| 1649 | Oliver Cromwell abolit la monarchie en Angleterre |
| 1669 | Première édition des Pensées de Pascal |
| 1683 | Jean Sobieski sauve Vienne des Turcs |
| 1685 | Révocation de l’Edit de Nantes |