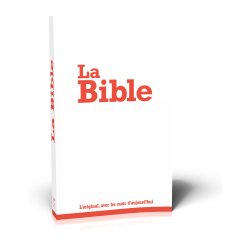La papauté a perdu une grande partie de sa crédibilité lors de son séjour à Avignon et pendant toute la durée du Grand Schisme. Pour sortir de la crise, évêques et cardinaux décident de donner au concile une autorité supérieure à celle du pape. Mais cette tentative de réforme échouera devant le refus des souverains pontifes de céder une partie de leur suprématie monarchique. La papauté poursuit son déclin.
Pise, 1409. Evêques et cardinaux sont réunis pour tenter de trouver une solution au Grand Schisme, qui divise la papauté en deux camps irréconciliables depuis 1378. Une idée s’impose: déposer les deux papes du moment, Benoît XIII et Grégoire XII, et les remplacer par un nouveau souverain pontife. Les pères conciliaires élisent Alexandre V. Mais les deux papes évincés refusent d’abdiquer. La chrétienté a désormais trois souverains pontifes. Lorsque, un an plus tard, Alexandre V meurt, Jean XXIII prend aussitôt sa place. La situation devient impossible. Sigismond, fils de l’empereur Charles IV, convainc Jean XXIII (pape déclaré non canonique par la suite, ce qui a permis au cardinal Angelo Giuseppe Roncalli de reprendre ce nom en 1958) de convoquer un nouveau concile.
Constance, 1414. Le concile, qui a admis en son sein des universitaires, s’ouvre dans une relative tranquillité. Il va durer quatre ans. Jean XXIII consent à abdiquer, à condition que ses deux rivaux en fassent de même. Grégoire XII est d’accord. Sans attendre la réponse de Benoît XIII, qui s’obstinera dans son refus, Jean XXIII s’enfuit, pressentant sans doute que les choses vont mal tourner pour lui. Il sera en effet considéré comme un usurpateur par la suite. Décapité, le concile décide pourtant de continuer à siéger. Le 6 avril 1415, il publie Sacrosancta, un décret resté célèbre, qui affirme que le concile «tient son pouvoir directement du Christ; tout homme, quel que soit son état ou sa dignité, cette dernière fût-elle papale, est tenu de lui obéir pour tout ce qui touche à la foi et à l’extirpation du schisme susdit, ainsi qu’à la réforme de la susdite Eglise de Dieu dans sa tête et dans ses membres».
En novembre 1417, un unique et nouveau pape est élu: Martin V. Le Grand Schisme est terminé. Echaudés par cette terrible expérience, les pères conciliaires ont décidé, avant l’élection du nouveau pape, que les conciles se réuniront sur une base régulière. Le calendrier des réunions sera plus ou moins tenu au début. Mais très vite, les papes s’opposeront à toute velléité de réforme et à tout amoindrissement de leur pouvoir monarchique. Aucun pape ne respectera le décret Sacrosancta. Néanmoins, la papauté retrouvera un fonctionnement administratif normal durant le XVe siècle, sans pour autant récupérer sa légitimité morale.
Après l’échec du concile de Pavie en 1424, Martin V convoque, comme le prévoit le calendrier élaboré à Constance, un nouveau concile à Bâle en 1431. La réforme est à l’ordre du jour, et les pères conciliaires, parmi lesquels les universitaires forment la majorité, manifestent d’emblée leur hostilité à la suprématie monarchique du pape. Nombreux sont les pères qui estiment que la souveraineté en matière de foi et de gouvernement doit revenir au corps de l’Eglise, c’est-à-dire à la foule des croyants. La majorité soutient que le concile a une autorité supérieure à celle du pape, qui reste toutefois nécessaire pour assumer le pouvoir exécutif.
La grande réussite du concile de Bâle est d’abolir les excès du système fiscal du Saint-Siège. En revanche, il manifeste son opposition à la réunification avec les Grecs, dont l’empereur a demandé l’aide de l’Occident pour lutter contre les Turcs. Le nouveau pape Eugène IV en profite pour transférer le concile à Ferrare, puis à Florence, où il négocie avec les Grecs. Ceux qui sont restés à Bâle excommunient Eugène IV et élisent un antipape, Félix V.
La rupture de 1054 entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise latine n’avait pas encore à l’époque le caractère définitif que nous lui attribuons aujourd’hui. En fait, les historiens estiment qu’il est impossible de fixer un commencement précis au schisme entre les deux chrétientés. Mais il est certain que l’épisode de la quatrième croisade a été décisif. En 1203, les croisés avaient mis le cap sur Constantinople contre la volonté du pape Innocent III. En 1204, la ville était pillée et saccagée. Les croisés l’occupèrent jusqu’en 1261, date à laquelle Michel Paléologue réussit à la reprendre. Après ces événements, une première tentative de réunification avait eu lieu lors du concile de Lyon en 1274. Mais des intérêts politiques divergents, ainsi que le refus des Byzantins d’accepter la primauté du pape et le Filioque, firent échouer l’Union à peine née.
Lorsque, au XVe siècle, les Grecs demandent l’aide de l’Occident contre les Turcs qui menacent d’envahir Constantinople, ils sont en position de faiblesse. Au concile de Florence, en 1439, ils acceptent la doctrine romaine du Filioque ainsi que la primauté du pape. Mais leurs motivations ne sont pas uniquement politiques: la plupart des théologiens byzantins présents se montrent soucieux de restaurer l’unité avec l’Eglise latine. Un décret d’union est signé le 5 juillet 1439. Une fois rentrés à Constantinople, l’empereur, le patriarche et les autres membres de la délégation n’arrivent pas à faire accepter les concessions de l’Union au peuple et au clergé byzantins. Quant aux Eglises orthodoxes non byzantines, elles refusent cet accord. De leur côté, les Occidentaux ne respecteront pas les termes de l’Union. Ils ne lèveront pas le petit doigt lorsque Constantinople tombera aux mains des Turcs en 1453.
La crise conciliaire prend fin en 1449. Isolé, l’antipape Félix V abdique. Le conciliarisme, s’il a contribué à sortir l’Eglise du Grand Schisme, a échoué dans sa prétention à réformer l’Eglise, en butant sur le refus des papes de voir diminuer leur pouvoir monarchique. Le déclin de la papauté et de la vie religieuse se poursuit.
En Italie, la Renaissance emporte les hommes dans un grand tourbillon artistique et politique, et ne manque pas de happer la papauté, qui à vrai dire n’oppose aucune résistance. A nouveau, la spiritualité fait les frais de papes qui ne pensent qu’au luxe et à la politique. Nicolas V fait de Rome une capitale culturelle, et ordonne la reconstruction de Saint-Pierre et de la ville. Son successeur Calixte III (1445-1458), le premier des Borgia, a recours au népotisme. Sixte IV (1471-1484), à qui l’on doit la construction de la chapelle Sixtine, «transforme la monarchie pontificale en une grande puissance italienne», écrit l’historien David Knowles.
Le Saint-Siège est pris dans les imbroglios de la politique italienne et entretient des relations pacifiques ou guerrières avec les nations d’Europe. Avec Innocent VIII (1484-1492), la papauté du XVe siècle touche le fond: corruption, vénalité, népotisme, faux privilèges, fausses bulles, intrigues sont des mesures courantes. Son successeur Alexandre VI Borgia (1492-1503) achète son élection.
Sous son règne, des fêtes organisées à la cour romaine tournent à l’orgie. Le pape est lui-même le père de Lucrèce et César Borgia, de sinistre réputation. Le dominicain florentin Savonarole, qui s’en prend violemment aux abus de l’Eglise («Arrive ici, Eglise infâme, écoute ce que te dit le Seigneur […]. Ta luxure a fait de toi une fille de joie défigurée. Tu es pire qu’une bête: tu es un monstre abominable»), meurt sur le bûcher en 1498.
Si la papauté se refuse à toute réforme, de peur de perdre ses privilèges, quelques velléités de redressement se font jour dans le monde catholique. Cependant, elles sont trop isolées pour susciter un mouvement d’ampleur. Nombreux sont pourtant les hommes et les femmes qui cherchent un approfondissement de leur vie spirituelle. L’anticléricalisme ne diminue pas la ferveur religieuse. La devotio moderna, née aux Pays-Bas à la fin du XIVe siècle, connaît son apogée au XVe siècle. Elle prône une vie communautaire dans le travail et la prière, et une spiritualité simple centrée sur l’imitation de Jésus-Christ.
Grâce à l’apparition de l’imprimerie, le retour à la Bible s’accentue. L’accès facilité au Nouveau Testament, notamment dans sa version originale grecque, et aux Pères de l’Eglise, permet de mieux comprendre quelles ont été la vie et les pratiques des premiers chrétiens. Le souhait d’une foi directe, qui ne passe pas par l’intermédiaire d’un prêtre et des sacrements, mais qui se joue dans l’intimité de la relation entre l’homme et le Christ, touche de plus en plus de croyants au Nord.
Par Patricia Briel, www.letemps.ch
Dates jalon
| 1414-1418 | Concile de Constance |
| 1415 | Jan Hus est condamné au bûcher |
| 1417 | Martin V est élu pape |
| 1420-1431 | La Bohême est secouée par les guerres hussites |
| 1431 | Jeanne d’Arc est brûlée à Rouen |
| 1431-1449 | Concile de Bâle |
| 1439 | Union des Eglises grecque et latines au concile de Florence |
| 1453 | Les Turcs s’emparent de Constantinople. Fin de la guerre de Cent Ans |
| 1456 | Gutenberg imprime la première Bible à Mayence |
| 1467 | Une Eglise séparée s’établit en Bohême |
| 1479-1516 | Règne de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle, roi et reine d’Espagne |
| 1492 | Christophe Colomb découvre l’Amérique |