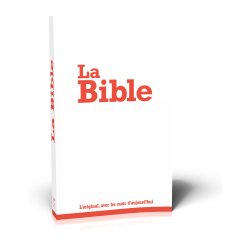Le pape Grégoire VII met en place une réforme vigoureuse pour lutter contre le laisser-aller général qui affecte l’Eglise. Il revendique des pouvoirs considérables pour la papauté, et la fin de la mainmise du pouvoir temporel sur les nominations épiscopales. C’est aussi l’heure de la première croisade.
«Quiconque a été promu par simonie, c’est-à-dire à prix d’argent, à l’un des ordres sacrés ou à une charge ecclésiastique ne pourra désormais exercer aucun ministère dans la sainte Eglise. Ceux qui obtiennent des églises à prix d’argent perdent ces églises. Personne ne pourra désormais acheter ou vendre des églises. Ceux qui ont commis le crime de fornication [les prêtres mariés, n.d.l.r.] ne pourront célébrer la messe […]. Nous décidons aussi que le peuple ne pourra assister aux offices de ceux qui ont méprisé nos constitutions […].»
Au concile de Rome, qui se tient en 1074, le pape Grégoire VII, monté sur le trône de Saint-Pierre l’année précédente, prend des décisions vigoureuses pour éradiquer définitivement la simonie et le nicolaïsme, ces pratiques qui gangrenaient l’Eglise depuis le Xe siècle. En 1075, il publie une série de décrets qui centralisent le pouvoir dans les mains du pape comme jamais auparavant. Ce faisant, il lance ce que les historiens appelleront plus tard la réforme grégorienne, qui permit à la papauté de prendre véritablement les rênes de l’Eglise.
Il était temps: la mainmise des seigneurs féodaux sur le monde religieux, qui se traduisait par la nomination d’évêques à prix d’argent (simonie), avait largement contribué à discréditer l’Eglise. La papauté, jouet des familles romaines, avait sombré au siècle précédent dans la décadence, pour ensuite se mettre au service des empereurs germaniques. Le clergé était proprement enlisé dans la société laïque. Le renouveau spirituel et intellectuel auquel la fondation de l’abbaye de Cluny avait donné le coup d’envoi s’était épanoui essentiellement à l’ombre des monastères. Cependant, il avait semé des ferments de réforme qui portèrent leurs fruits au XIe siècle.
Tout au long de la première moitié du XIe siècle, la situation politique s’était stabilisée en Europe. Depuis 962, date à laquelle le roi de Germanie Otton le Grand fut couronné par Jean XII, les papes étaient soumis à l’empereur, ce qui n’allait pas sans poser de graves problèmes avec l’aristocratie romaine. Celle-ci acceptait difficilement des étrangers pour souverains pontifes. Peu à peu, l’idée émergea qu’il fallait créer un clergé discipliné et indépendant des seigneurs laïcs, qui serait consacré selon le droit canon et soumis directement au pape.
La réforme grégorienne eut deux précurseurs: Léon IX et Nicolas II. Le premier accéda au Saint-Siège en 1049. Rapidement, il condamna les pratiques simoniaques et le mariage des prêtres (nicolaïsme). Il mourut en 1054. Quatre ans plus tard, en décembre 1058, Nicolas II reprit le flambeau de la réforme. Sous l’influence du moine Hildebrand, qui devait devenir pape sous le nom de Grégoire VII, il promulgua le 13 avril 1059 un célèbre décret qui remettait l’élection du pape dans les seules mains des cardinaux et dérobait ainsi sa nomination au pouvoir temporel. Il s’attaqua également à la simonie et au nicolaïsme, en interdisant aux croyants d’assister à une messe célébrée par un prêtre marié et aux clercs de recevoir une église des mains d’un laïc. Après sa mort en 1061, Alexandre II poursuivit ces réformes.
Hildebrand accède au pontificat après la mort d’Alexandre II en avril 1073. Ce moine est décidé à lancer une réforme d’envergure. En 1074, on l’a vu, il réitère les mesures de ses prédécesseurs contre la simonie et le nicolaïsme. A ses yeux, tous les maux dont souffre l’Eglise viennent de l’investiture laïque. Il faut donc s’en débarrasser en rendant l’épiscopat libre de toute tutelle temporelle. Seule une réforme de l’autorité pontificale peut y parvenir. Entre 1074 et 1075, Grégoire VII élabore un programme connu sous le nom de «Dictatus papae», dans lequel il revendique pour la papauté des pouvoirs considérables. «Seul le pontife romain est dit à juste titre universel. Seul, il peut déposer ou absoudre les évêques. Le pape est le seul homme dont tous les princes baisent les pieds. Il lui est permis de déposer les empereurs. L’Eglise romaine n’a jamais erré; et selon le témoignage de l’Ecriture, elle n’errera jamais…»
Ce programme ne peut qu’offenser l’empereur, peu disposé à laisser échapper sa mainmise sur l’Eglise. La querelle des investitures s’aggrave lorsqu’en 1076, une assemblée d’évêques réfractaires à la réforme grégorienne accepte de déposer le pape sur les instances de l’empereur Henri IV. Grégoire VII réplique en excommuniant ce dernier, une mesure sans précédent. A Canossa, où le pape séjourne en janvier 1077, Henri IV se repent de ses fautes, et Grégoire l’absout. Leurs relations ne s’améliorent pas pour autant. Le pape procédera à une seconde excommunication le 7 mars 1080. Déposé par les empereurs et les évêques allemands, qui installeront l’antipape Clément III à sa place, il mourra en exil en mai 1085.
Bien qu’il ne fût pas un novateur, puisqu’il avait puisé sa réforme dans les lois canoniques anciennes et dans l’action de ses prédécesseurs, Grégoire VII réussit à réorganiser complètement l’Eglise et à la libérer effectivement de la tutelle laïque. Il permit ainsi, comme le remarque l’historien David Knowles*, que le pouvoir spirituel, devenu indépendant, «non seulement dure pendant tout le bas Moyen Age, mais aussi au cours des siècles suivants». A ce titre, les trente ou quarante ans qui ont vu le plein développement de la réforme, dont l’apogée se situe précisément sous Grégoire VII, «constituent une ligne de partage dans l’histoire de l’Europe, une brève époque durant laquelle se produisit une évolution importante et durable […]».
La réforme monastique du Xe siècle avait préparé le terrain à celle de l’Eglise. Au XIe siècle, elle se poursuit et prend un nouveau virage. Tandis que Cluny connaît ses plus beaux jours sous la direction de l’abbé Hugues (1049-1109), de nouvelles formes de vie monastique émergent alors, plus austères et portées vers l’érémitisme. Les précurseurs de ce mouvement ont sans doute été des moines italiens. Romuald de Ravenne (vers 950-1027) projette de restaurer la vie monastique du désert. Il laisse derrière lui un groupe d’ermites à Camaldoli dans les Apennins. A Vallombreuse, Jean Gualbert (vers 990-1073) fonde une communauté, où les moines observent une clôture stricte et un silence absolu. Pierre Damien (1007-1072), un ancien ermite qui a joué un grand rôle à la Curie, critique la société dépravée. L’époque voit naître également la Grande Chartreuse, en 1084, et l’ordre cistercien avec la fondation de Cîteaux en 1098 par Robert de Molesmes.
Tout au long du XIe siècle, la chrétienté occidentale prend peu à peu conscience de son unité. En 1054 intervient le schisme entre l’Eglise d’Orient et celle d’Occident. Pourtant, les contemporains ne se rendent pas compte de la gravité de l’événement, qui apparaît à l’époque comme l’un des nombreux conflits qui ont traversé l’histoire des relations entre les deux parties du monde chrétien. Ce qui va souder la chrétienté occidentale, c’est la guerre sainte. Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II appelle à la croisade lors d’un concile à Clermont. Jérusalem est aux mains des Turcs, qui menacent maintenant Constantinople. L’empereur byzantin Alexis a demandé de l’aide aux Latins.
Les historiens discutent encore aujourd’hui des motifs qui ont poussé Urbain II à lancer la croisade. A-t-il voulu donner un exutoire à la violence des chevaliers qui menaient des guerres féodales en Occident? Souhaitait-il reprendre l’initiative politique et se poser en chef de la chrétienté? Les deux hypothèses sont plausibles. Quoi qu’il en soit, l’idée d’aller libérer les Lieux Saints a rencontré un énorme élan d’enthousiasme. Les foules de pauvres et de chevaliers se mettent en marche, et commencent par passer les juifs qu’ils rencontrent sur leur passage au fil de l’épée, car ceux-ci sont considérés comme déicides.
Le 15 juillet 1099, Jérusalem est prise dans un grand bain de sang. Le pouvoir de la papauté sort grandi des croisades, mais l’Eglise y laisse une partie de son âme. Comme l’écrit Jacques Le Goff**, grand spécialiste de l’histoire du Moyen Age, «la Croisade, si elle montre une chrétienté enfin sûre d’elle-même, la montre aussi devenue allergique à autrui. Elle ne cherche plus qu’accessoirement à convertir, elle massacre».
Par Patricia Briel, www.letemps
Dates jalon
| 1001 | Saint Etienne est couronné roi de Hongrie |
| 1049-1054 | Pontificat de Léon IX |
| 1049-1109 | Hugues est abbé de Cluny |
| 1054 | Schisme entre l’Orient et l’Occident |
| 1056-1106 | Règne d’Henri IV |
| 1059 | Le pape Nicolas II publie un décret sur les modalités de l’élection pontificale |
| 1073-1085 | Pontificat de Grégoire VII |
| 1076 | Le concile de Worms dépose Grégoire VII qui excommunie Henri IV |
| 1077 | Canossa |
| 1080 | Excommunication finale d’Henri IV |
| 1084 | Fondation de la Grande Chartreuse par saint Bruno |
| 1088-1099 | Pontificat d’Urbain II |
| 1095 | Urbain II appelle à la croisade à Clermont |
| 1098 | Fondation de Cîteaux |
| 1099 | Prise de Jérusalem par les Croisés |
* David Knowles, Nouvelle Histoire de l’Eglise, Seuil, 1968
** Jacques Le Goff, Le Christianisme médiéval en Occident du concile de Nicée à la Réforme, in: Histoire des religions, tome 2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972